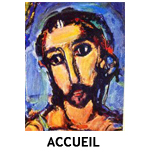Jean-Pierre Jeunet tente de se renouveler et de créer un nouvel opus à la hauteur d'Amélie Poulain. Le résultat, Un long dimanche de fiançailles est singulièrement dépourvu d'âme et de cohérence.
Ce n'est pas facile de donner une suite à une grande oeuvre. Jean-Pierre Jeunet était attendu au tournant, comme bien d'autres avant lui, depuis le succès international de son précédent opus, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Les artistes placés face à ce défi, dans le passé, ont répondu de façon diverse. Certains ont temporisé, d'autres ont tenté le renouvellement complet, d'autres enfin ont poursuivi dans la même veine. Jean-Pierre Jeunet, avec son nouveau film, « un long dimanche de fiançailles », ne choisit pas et fait un peu des trois.
L'argument, inspiré d'un roman de Sébastien Japrisot publié il y a une bonne dizaine d'années, est l'un des plus classiques qui se soit trouvé jusqu'à présent devant la caméra du réalisateur. Les bizarreries baroques de Delicatessen et de la Cité des Enfants Perdus ; la fiesta gore de Alien Résurrection ; et le conte pour adultes d'Amélie Poulain cèdent à un argument somme toute très fréquenté : une femme à la recherche de nouvelles sur son fiancé, Mannech, soldat pendant la Grande Guerre.
Là où l'argument se distingue des autres, c'est que ce soldat a été condamné à mort en 17 avec quatre autres. Non pour une de ces mutineries dont Lionel Jospin avait remis le souvenir à la mode, mais pour une automutilation ; comme nous l'avons appris en cours d'histoire, c'était le moyen le plus sûr d'être démobilisé. Ou traduit devant un tribunal militaire et condamné à mort. Dans le cas des cinq qui nous occupent, cela voulait dire abandonnés dans le no man's land entre les tranchées françaises et allemandes. L'histoire nous rapporte que les mutineries et les insubordinations de 17 se sont traduites en cinq centaines de condamnations à mort, dont cinquante ont été effectivement exécutées (d'où la légende des « décimations », que mon professeur d'allemand de sixième propageait encore). Le film commence donc par nous présenter le sort de ce millième de condamnés, jusqu'au moment où ils sont « basculés par-dessus le parapet ».
La « veuve » de Mannech, (Audrey Tautou) dans sa ferme de Bretagne, a le sentiment que son fiancé n'est pas mort. Nous sommes alors en 1920, et elle va commencer de se dépenser pour retrouver sa trace. Détective privé, coffre aux souvenirs retrouvé, voyages, incessants voyages, dans toute la France, coïncidences, coups de théâtre. On ne trahira pas un grand secret en avouant que oui, Mathilde retrouve son Mannech.
Nous retrouvons quant à nous quelques acteurs que nous sommes habitués à voir chez Jeunet : Dominique Pinon, Audrey Tautou, Ticky Holgado, Françis Dreyfus (toujours dans un rôle de gros dégoûtant). Saluons l'apparition d'André Dussollier, Jean-Pierre Daroussin, et de Jodie Foster (mais oui). Le méchant épicier Colignon est devenu un méchant curé de campagne ; le reste à l'avenant.
Nous l'avons dit, il y a à la fois de neuf et du vieux dans ce film. Le vieux, c'est ce style Jeunet, un peu bizarre, un peu loufoque, avec lequel le pays entier est familier depuis Amélie. De nombreux éléments de ce film en vert et rouge s'y retrouvent d'ailleurs. La narration en voix off : la genèse de Mathilde est présentée comme un état civil, comme celui d'Amélie mais de manière moins décalée (la mère de Mathilde ne se prend pas de touriste canadien sur la tête à la sortie d'une église). Les illustrations visuelles d'une seconde. L'oncle est menuisier : nous avons trois clips d'une seconde où le menuisier rabote, cloue, coupe. Un des condamnés est soudeur : c'est immanquable, on le voit qui soude. A rapprocher, dans Amélie, de « madame Poulain aime : les patineuses artistiques à la télé sur TF1, faire craquer ses doigts, vider son sac, tout nettoyer, et tout ranger en ordre dedans ». Nous n'échappons pas aux intérieurs anciens ; les bibelots à coquillages, l'évier en céramique. Nous n'échappons pas aux plans sur les parigots de Paname, dont un bien gratiné sur Montmartre où rien ne manque : le Sacré Coeur, et des moulins comme s'il en pleuvait. Nous n'échappons pas non plus, hélas, au gag a répétition franchement lourd du facteur qui dérape sur le gravier. Quatre fois ? Cinq fois ?
Le style narratif est encore du Jeunet classique : voix off omniprésente, images retravaillées (dans un ton sépia cette fois), narration toujours entre coq et âne. Mais ce qui était simple à suivre dans Amélie devient ici d'une complexité qui rappelle le scénario des Rivières Pourpres (et de son DVD de bonus, dans lequel les acteurs avouaient n'y avoir rien compris). On suit une piste, puis deux en même temps ; il y a une passionaria corse qui en suit d'autres, il y a des substitutions d'identité, des bottes allemandes cruciales pour l'intrigue et qui changent sans cesse de propriétaire. Bref, au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien et on se laisse porter sans plus broncher, confiant que, le film étant grand public, tout ce faisceau de pistes se réduira en temps opportun. On admire à la place la reconstitution de la gare d'Orsay ou de la place de l'Opéra.
Le neuf, c'est le classicisme relatif du scénario, dont nous avons parlé. Le problème, c'est que Jeunet n'est pas équipé pour affronter sereinement le filmage d'une histoire classique. Son style fait merveille dans les récits un peu étranges ; dès lors qu'il faut raconter quelque chose de normal, il se cherche. Et, la nature ayant horreur du vide, il emprunte à tour de bras. Le plan d'ouverture a quelque chose du documentaire d'un hypothétique Maurice Faillevic sur la Grande Guerre : la météo invariablement mauvaise, la tranchée boueuse, la musique sombre : on est prévenus que ça ne sera pas drôle. Mais, dès lors qu'une attaque d'artillerie est menée, on passe au style du Soldat Ryan : ça tombe de tout les côtés, boum, boum, badaboum (et quelques cris dans le fond). Fait-on alors un assaut ? Ce sont les visuels des Chemins de la Gloire (Kubrick) que l'on retrouve ; pour un peu on croirait voir Kirk Douglas entraîner ses hommes hors de la tranchée avec son drôle de sifflet. Quant à l'argument, par son invraisemblance, il rappelle à nouveau celui du Soldat Ryan.
Le ton du film, de même, se cherche. 1917, les cinq condamnés, c'est du passé, et c'est la guerre. Le présent, c'est un film de détective ou les révélations se succèdent au rythme d'une toutes les cinq minutes ; mais comme elles ont toutes rapport aux événements du front, elles sont suivies d'un flash-back et le retour du style Soldat Ryan. Cela fait beaucoup d'explosions, beaucoup de bruit, et cela devient lassant au bout d'un moment à force de régularité : on revient toujours sur le même moment, sous des angles différents, trois fois, quatre fois on voit la même bombe qui tombe sans exploser. On est aussi gratifié de nombreux plans de trains dans la campagne (très bruyants eux aussi) ; et dire qu'on reprochait à Peter Jackson de faire trop de sweeps d'hélicoptère dans ses films !
C'est d'autant plus dommage que la technique narrative est au point (les « jeunetismes » sont une chose originale, qui soutient naturellement l'attention) et que tous les plans, sans exceptions, sont extrêmement travaillés et quasi parfaits. Le style volontiers intimiste de Jeunet s'agrémente, pour notre plus grand plaisir, de grandes vues en plain air (la lande bretonne, un phare) très travaillées et réussies elles aussi.
Le jeu d'Audrey Tautou se cherche d'une façon similaire. Parfois elle est une resucée d'Amélie (quand elle fait la moue à Colignon, quand elle répond « j'ai du travail » à la lesbienne du XVIème). Amélie trempait sa main dans les sacs de graine ; Mathilde fait des paris : « si j'arrive au virage avant la voiture, Mannech est vivant ».
D'autres fois, elle est une jeune veuve ; émouvante lors de son unique scène d'amour avec Mannech, mais un peu stéréotypée par la suite. De fait, à force de chercher, de faire le détective, elle en oublie de se laisser vivre, et on sort du film sans avoir une traître idée de son caractère (à part qu'elle est tenace). Ce défaut affecte pratiquement tous les autres personnages du film : ils n'ont guère d'épaisseur, ce sont des pions et des stéréotypes. Dreyfus pousse des râles de plaisir, Pinon pince les lèvres, Holgado parle avé l'assent comme jamais. On devine que si Christian Clavier avait été de la partie, il aurait campé un parvenu hyperexcité. Mais ce qui passait dans ce conte de fées moderne qu'est Amélie dénote franchement lorsqu'on en vient à un drame aux accents réalistes comme ce « Dimanche ». Mathilde est une fiancée, pas un petit lutin qui veut le bonheur des gens ; elle est emporté dans un tourbillon de lutin ; voyage, questionne, part, cherche, découvre, fait des plans, voyage, voyage, voyage. Dans tout cela bien peu d'émotion.
L'émotion se retrouve mieux dans les scènes de tranchées ; il est vrai que c'est plus facile à créer. Des pauvres hères en bleu horizon, pas rasés, dans la gadoue ; livrés à des officiers sadiques : on devine vite l'image que Jeunet veut donner de la Grande Guerre : ce n'est pas celle de Montherlant ou de Drieu, c'est plutôt celle de « c'est à Craonne », d'ailleurs chantée lors d'une scène de film. Ça pleut, ça grelotte, ça meurt, ça mitraille ; mais comme on est dans un film grand public, les balles font des trous d'épingle et les « épis mûrs et les blés moissonnés » (ô Péguy !) font une gracieuse pirouette avant de tomber dans la boue qui amortit le choc, avec une prédilection pour les endroits où il y en a le plus (de boue). Les officiers sont des sadiques tirés à quatre épingles, ou des gros plantureux, jurant comme des charretiers, seuls responsables de la mort de leurs hommes qu'ils abattent parfois dans le dos. Les poilus sont tous de brave gars du peuple pas méchants dans le fond. Les sous officiers sont les pires. Pas une fois les politiques ne sont mis en cause. Poincaré est disculpé, et Pétain seul est accablé (personne n'ira disputer cela). A croire que c'est l'armée qui a déclaré la guerre en 14.
A force, le spectateur se trouve plongé dans un monde où la seule rémission est un bol de chocolat piqué à la cantine ; où les violons chantent sans cesse en mineur, et où la même scène de massacre revient toutes les dix minutes ; la seule réalité, c'est la mort, le cinéaste nous le rappelle avec une lourdeur qui frise le film de propagande. La guerre, c'est l'enfer, nous l'avons vite compris, et nous avons presque aussi vite compris que nous y serions plongés, dans cet enfer, sans mesure raisonnable. Comme si cela ne suffisait pas, on nous sert sur un plateau le bombardement d'un hôpital de campagne, installé dans un hangar à dirigeables. Il y a du feu de partout, ça crie, ça s'enfuit (mais les portes sont fermées, bien entendu) et je commence à soupçonner le réalisateur de se complaire dans un certain sadisme. L'explosion meurtrière est filmée à la Jeunet ; mais ce qui faisait rire avec les puces savantes de Marcello dans la Cité des Enfants Perdus consterne ici. On aurait pu en bombarder deux, trois, dix, d'hôpitaux, cela n'aurait rien changé.
Si la frénésie de destruction ne vous a pas suffi, préparez-vous pour la guillotine. Oui, entre deux pilonnages, Jeunet a réussi à nous glisser une exécution. Je ne comprends toujours pas le pourquoi de la scène ; c'est un personnage secondaire qui y passe, après avoir fait avancer l'intrigue dans une scène précédente ; aucun autre héros du film n'y est présent ; c'est une scène inutile et gratuite. Elle est filmée en noir et blanc, de manière très crue, comme un film d'archive, sans aucun son ni bruit ni mouvement de caméra. Ce traitement lui donne un relief incroyable, et, aux spectateurs, une nausée à la mesure de ce qu'on lui inflige. Conservez votre bac de pop corn vide, vous risquez d'en avoir besoin. Dans un langage normal, celui d'un Kieslowski dans « tu ne tueras point », cette mise en scène serait la scène centrale du film. Ici, c'est juste un clip glissé dans le film, gratuit, révoltant et parfaitement inutile. Que voulait nous dire le réalisateur ? que la peine de mort, c'est mal ? qu'il est contre la mort ? On se perd en conjectures.
Enfin, Mannech est retrouvé (oui, oui, il était vivant). Mais... (roulement de tambour) il est amnésique ! Oh non, le cliché ! Vous ne l'aviez pas vu venir, hein ? Mathilde le retrouve quand même, la nature refleurit, ils sont heureux, envoyez le générique. Ouais, ça se finit comme ça. Amélie qui se précipitait vers la porte, l'ouvrait en coup de vent et se trouvait nez à nez avec Matthieu Kassowitz, c'était du niveau de Friends. Mais l'amnésie, ça ne vaut même pas le Club des Cinq où l'on en fait un usage plus parcimonieux autant que vraisemblable.
« Un long dimanche de fiançailles » est parti de manière irréfléchie sur le registre « conte de fées pour adultes » qui avait valu à Amélie Poulain son grand succès. Mais il n'a pas tenu face à l'ampleur du drame qu'il lui aurait fallu représenter, et qui ne transparaît sur l'écran que comme une répétition de scènes choc, souvent révoltantes, qui dispensent le réalisateur d'approfondir la psychologie des personnages. Ce dernier s'efforce alors de soutenir l'attention du spectateur par une accumulation envahissante de tics de narration qui ne couvrent pas, finalement, la ténuité de l'intrigue mais en font au contraire un salmigondis duquel on a de plus en plus de mal à se dégager au fur et à mesure que le film se déroule.
Ce n'est pas facile de donner une suite à une grande oeuvre. Jean-Pierre Jeunet était attendu au tournant, comme bien d'autres avant lui, depuis le succès international de son précédent opus, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Les artistes placés face à ce défi, dans le passé, ont répondu de façon diverse. Certains ont temporisé, d'autres ont tenté le renouvellement complet, d'autres enfin ont poursuivi dans la même veine. Jean-Pierre Jeunet, avec son nouveau film, « un long dimanche de fiançailles », ne choisit pas et fait un peu des trois.
L'argument, inspiré d'un roman de Sébastien Japrisot publié il y a une bonne dizaine d'années, est l'un des plus classiques qui se soit trouvé jusqu'à présent devant la caméra du réalisateur. Les bizarreries baroques de Delicatessen et de la Cité des Enfants Perdus ; la fiesta gore de Alien Résurrection ; et le conte pour adultes d'Amélie Poulain cèdent à un argument somme toute très fréquenté : une femme à la recherche de nouvelles sur son fiancé, Mannech, soldat pendant la Grande Guerre.
Là où l'argument se distingue des autres, c'est que ce soldat a été condamné à mort en 17 avec quatre autres. Non pour une de ces mutineries dont Lionel Jospin avait remis le souvenir à la mode, mais pour une automutilation ; comme nous l'avons appris en cours d'histoire, c'était le moyen le plus sûr d'être démobilisé. Ou traduit devant un tribunal militaire et condamné à mort. Dans le cas des cinq qui nous occupent, cela voulait dire abandonnés dans le no man's land entre les tranchées françaises et allemandes. L'histoire nous rapporte que les mutineries et les insubordinations de 17 se sont traduites en cinq centaines de condamnations à mort, dont cinquante ont été effectivement exécutées (d'où la légende des « décimations », que mon professeur d'allemand de sixième propageait encore). Le film commence donc par nous présenter le sort de ce millième de condamnés, jusqu'au moment où ils sont « basculés par-dessus le parapet ».
La « veuve » de Mannech, (Audrey Tautou) dans sa ferme de Bretagne, a le sentiment que son fiancé n'est pas mort. Nous sommes alors en 1920, et elle va commencer de se dépenser pour retrouver sa trace. Détective privé, coffre aux souvenirs retrouvé, voyages, incessants voyages, dans toute la France, coïncidences, coups de théâtre. On ne trahira pas un grand secret en avouant que oui, Mathilde retrouve son Mannech.
Nous retrouvons quant à nous quelques acteurs que nous sommes habitués à voir chez Jeunet : Dominique Pinon, Audrey Tautou, Ticky Holgado, Françis Dreyfus (toujours dans un rôle de gros dégoûtant). Saluons l'apparition d'André Dussollier, Jean-Pierre Daroussin, et de Jodie Foster (mais oui). Le méchant épicier Colignon est devenu un méchant curé de campagne ; le reste à l'avenant.
Nous l'avons dit, il y a à la fois de neuf et du vieux dans ce film. Le vieux, c'est ce style Jeunet, un peu bizarre, un peu loufoque, avec lequel le pays entier est familier depuis Amélie. De nombreux éléments de ce film en vert et rouge s'y retrouvent d'ailleurs. La narration en voix off : la genèse de Mathilde est présentée comme un état civil, comme celui d'Amélie mais de manière moins décalée (la mère de Mathilde ne se prend pas de touriste canadien sur la tête à la sortie d'une église). Les illustrations visuelles d'une seconde. L'oncle est menuisier : nous avons trois clips d'une seconde où le menuisier rabote, cloue, coupe. Un des condamnés est soudeur : c'est immanquable, on le voit qui soude. A rapprocher, dans Amélie, de « madame Poulain aime : les patineuses artistiques à la télé sur TF1, faire craquer ses doigts, vider son sac, tout nettoyer, et tout ranger en ordre dedans ». Nous n'échappons pas aux intérieurs anciens ; les bibelots à coquillages, l'évier en céramique. Nous n'échappons pas aux plans sur les parigots de Paname, dont un bien gratiné sur Montmartre où rien ne manque : le Sacré Coeur, et des moulins comme s'il en pleuvait. Nous n'échappons pas non plus, hélas, au gag a répétition franchement lourd du facteur qui dérape sur le gravier. Quatre fois ? Cinq fois ?
Le style narratif est encore du Jeunet classique : voix off omniprésente, images retravaillées (dans un ton sépia cette fois), narration toujours entre coq et âne. Mais ce qui était simple à suivre dans Amélie devient ici d'une complexité qui rappelle le scénario des Rivières Pourpres (et de son DVD de bonus, dans lequel les acteurs avouaient n'y avoir rien compris). On suit une piste, puis deux en même temps ; il y a une passionaria corse qui en suit d'autres, il y a des substitutions d'identité, des bottes allemandes cruciales pour l'intrigue et qui changent sans cesse de propriétaire. Bref, au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien et on se laisse porter sans plus broncher, confiant que, le film étant grand public, tout ce faisceau de pistes se réduira en temps opportun. On admire à la place la reconstitution de la gare d'Orsay ou de la place de l'Opéra.
Le neuf, c'est le classicisme relatif du scénario, dont nous avons parlé. Le problème, c'est que Jeunet n'est pas équipé pour affronter sereinement le filmage d'une histoire classique. Son style fait merveille dans les récits un peu étranges ; dès lors qu'il faut raconter quelque chose de normal, il se cherche. Et, la nature ayant horreur du vide, il emprunte à tour de bras. Le plan d'ouverture a quelque chose du documentaire d'un hypothétique Maurice Faillevic sur la Grande Guerre : la météo invariablement mauvaise, la tranchée boueuse, la musique sombre : on est prévenus que ça ne sera pas drôle. Mais, dès lors qu'une attaque d'artillerie est menée, on passe au style du Soldat Ryan : ça tombe de tout les côtés, boum, boum, badaboum (et quelques cris dans le fond). Fait-on alors un assaut ? Ce sont les visuels des Chemins de la Gloire (Kubrick) que l'on retrouve ; pour un peu on croirait voir Kirk Douglas entraîner ses hommes hors de la tranchée avec son drôle de sifflet. Quant à l'argument, par son invraisemblance, il rappelle à nouveau celui du Soldat Ryan.
Le ton du film, de même, se cherche. 1917, les cinq condamnés, c'est du passé, et c'est la guerre. Le présent, c'est un film de détective ou les révélations se succèdent au rythme d'une toutes les cinq minutes ; mais comme elles ont toutes rapport aux événements du front, elles sont suivies d'un flash-back et le retour du style Soldat Ryan. Cela fait beaucoup d'explosions, beaucoup de bruit, et cela devient lassant au bout d'un moment à force de régularité : on revient toujours sur le même moment, sous des angles différents, trois fois, quatre fois on voit la même bombe qui tombe sans exploser. On est aussi gratifié de nombreux plans de trains dans la campagne (très bruyants eux aussi) ; et dire qu'on reprochait à Peter Jackson de faire trop de sweeps d'hélicoptère dans ses films !
C'est d'autant plus dommage que la technique narrative est au point (les « jeunetismes » sont une chose originale, qui soutient naturellement l'attention) et que tous les plans, sans exceptions, sont extrêmement travaillés et quasi parfaits. Le style volontiers intimiste de Jeunet s'agrémente, pour notre plus grand plaisir, de grandes vues en plain air (la lande bretonne, un phare) très travaillées et réussies elles aussi.
Le jeu d'Audrey Tautou se cherche d'une façon similaire. Parfois elle est une resucée d'Amélie (quand elle fait la moue à Colignon, quand elle répond « j'ai du travail » à la lesbienne du XVIème). Amélie trempait sa main dans les sacs de graine ; Mathilde fait des paris : « si j'arrive au virage avant la voiture, Mannech est vivant ».
D'autres fois, elle est une jeune veuve ; émouvante lors de son unique scène d'amour avec Mannech, mais un peu stéréotypée par la suite. De fait, à force de chercher, de faire le détective, elle en oublie de se laisser vivre, et on sort du film sans avoir une traître idée de son caractère (à part qu'elle est tenace). Ce défaut affecte pratiquement tous les autres personnages du film : ils n'ont guère d'épaisseur, ce sont des pions et des stéréotypes. Dreyfus pousse des râles de plaisir, Pinon pince les lèvres, Holgado parle avé l'assent comme jamais. On devine que si Christian Clavier avait été de la partie, il aurait campé un parvenu hyperexcité. Mais ce qui passait dans ce conte de fées moderne qu'est Amélie dénote franchement lorsqu'on en vient à un drame aux accents réalistes comme ce « Dimanche ». Mathilde est une fiancée, pas un petit lutin qui veut le bonheur des gens ; elle est emporté dans un tourbillon de lutin ; voyage, questionne, part, cherche, découvre, fait des plans, voyage, voyage, voyage. Dans tout cela bien peu d'émotion.
L'émotion se retrouve mieux dans les scènes de tranchées ; il est vrai que c'est plus facile à créer. Des pauvres hères en bleu horizon, pas rasés, dans la gadoue ; livrés à des officiers sadiques : on devine vite l'image que Jeunet veut donner de la Grande Guerre : ce n'est pas celle de Montherlant ou de Drieu, c'est plutôt celle de « c'est à Craonne », d'ailleurs chantée lors d'une scène de film. Ça pleut, ça grelotte, ça meurt, ça mitraille ; mais comme on est dans un film grand public, les balles font des trous d'épingle et les « épis mûrs et les blés moissonnés » (ô Péguy !) font une gracieuse pirouette avant de tomber dans la boue qui amortit le choc, avec une prédilection pour les endroits où il y en a le plus (de boue). Les officiers sont des sadiques tirés à quatre épingles, ou des gros plantureux, jurant comme des charretiers, seuls responsables de la mort de leurs hommes qu'ils abattent parfois dans le dos. Les poilus sont tous de brave gars du peuple pas méchants dans le fond. Les sous officiers sont les pires. Pas une fois les politiques ne sont mis en cause. Poincaré est disculpé, et Pétain seul est accablé (personne n'ira disputer cela). A croire que c'est l'armée qui a déclaré la guerre en 14.
A force, le spectateur se trouve plongé dans un monde où la seule rémission est un bol de chocolat piqué à la cantine ; où les violons chantent sans cesse en mineur, et où la même scène de massacre revient toutes les dix minutes ; la seule réalité, c'est la mort, le cinéaste nous le rappelle avec une lourdeur qui frise le film de propagande. La guerre, c'est l'enfer, nous l'avons vite compris, et nous avons presque aussi vite compris que nous y serions plongés, dans cet enfer, sans mesure raisonnable. Comme si cela ne suffisait pas, on nous sert sur un plateau le bombardement d'un hôpital de campagne, installé dans un hangar à dirigeables. Il y a du feu de partout, ça crie, ça s'enfuit (mais les portes sont fermées, bien entendu) et je commence à soupçonner le réalisateur de se complaire dans un certain sadisme. L'explosion meurtrière est filmée à la Jeunet ; mais ce qui faisait rire avec les puces savantes de Marcello dans la Cité des Enfants Perdus consterne ici. On aurait pu en bombarder deux, trois, dix, d'hôpitaux, cela n'aurait rien changé.
Si la frénésie de destruction ne vous a pas suffi, préparez-vous pour la guillotine. Oui, entre deux pilonnages, Jeunet a réussi à nous glisser une exécution. Je ne comprends toujours pas le pourquoi de la scène ; c'est un personnage secondaire qui y passe, après avoir fait avancer l'intrigue dans une scène précédente ; aucun autre héros du film n'y est présent ; c'est une scène inutile et gratuite. Elle est filmée en noir et blanc, de manière très crue, comme un film d'archive, sans aucun son ni bruit ni mouvement de caméra. Ce traitement lui donne un relief incroyable, et, aux spectateurs, une nausée à la mesure de ce qu'on lui inflige. Conservez votre bac de pop corn vide, vous risquez d'en avoir besoin. Dans un langage normal, celui d'un Kieslowski dans « tu ne tueras point », cette mise en scène serait la scène centrale du film. Ici, c'est juste un clip glissé dans le film, gratuit, révoltant et parfaitement inutile. Que voulait nous dire le réalisateur ? que la peine de mort, c'est mal ? qu'il est contre la mort ? On se perd en conjectures.
Enfin, Mannech est retrouvé (oui, oui, il était vivant). Mais... (roulement de tambour) il est amnésique ! Oh non, le cliché ! Vous ne l'aviez pas vu venir, hein ? Mathilde le retrouve quand même, la nature refleurit, ils sont heureux, envoyez le générique. Ouais, ça se finit comme ça. Amélie qui se précipitait vers la porte, l'ouvrait en coup de vent et se trouvait nez à nez avec Matthieu Kassowitz, c'était du niveau de Friends. Mais l'amnésie, ça ne vaut même pas le Club des Cinq où l'on en fait un usage plus parcimonieux autant que vraisemblable.
« Un long dimanche de fiançailles » est parti de manière irréfléchie sur le registre « conte de fées pour adultes » qui avait valu à Amélie Poulain son grand succès. Mais il n'a pas tenu face à l'ampleur du drame qu'il lui aurait fallu représenter, et qui ne transparaît sur l'écran que comme une répétition de scènes choc, souvent révoltantes, qui dispensent le réalisateur d'approfondir la psychologie des personnages. Ce dernier s'efforce alors de soutenir l'attention du spectateur par une accumulation envahissante de tics de narration qui ne couvrent pas, finalement, la ténuité de l'intrigue mais en font au contraire un salmigondis duquel on a de plus en plus de mal à se dégager au fur et à mesure que le film se déroule.






 Les fils de l'homme (recension de Nelly)
Les fils de l'homme (recension de Nelly)