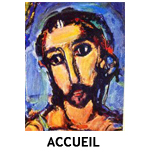C’est avec un certain enchantement que j’aborde cet article consacré au plus divertissant des romans d’aventure, un roman plein de vie et d’entrain, de mouvement, de couleur, de duels et d’amour, marqué par ce panache d’éloquence qui ne laisse pas d’enchanter le lecteur. On serait bien en peine de déceler dans ce livre l’« esprit républicain » exalté par le président Chirac lors de la pompeuse cérémonie qui a marqué l’entrée au Panthéon d’ Alexandre Dumas. Les chantres de la République ne sont décidément pas à une escroquerie intellectuelle près.
Le récit se déroule au temps de Louis XIII, où les intrigues politiques et les intrigues galantes s’enchevêtraient si bien les unes aux autres. C’est aussi à cette époque que se situe l’action du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, qui lui aussi a entrepris de faire revivre dans son roman l’esprit de ce temps. Comme le souligne le critique Antoine Adam, « Gautier a vu avec beaucoup de netteté que les raffinés et les bretteurs sont les types qui occupent le devant de la scène de cette époque. D’un côté l’homme d’épée qui ne songe qu’à se battre sous prétexte du point d’honneur. De l’autre l’habitué des salons, avec son goût pour les recherches d’esprit, pour les raffinements de langage, pour les subtilités de sentiment et d’expression que les historiens ont appelés plus tard la préciosité. Il ne s’agit pas ici de simples tableaux pittoresques évoquant le France de Louis XIII…Gautier sait que le Français est alors nourri de la lecture des romans de chevalerie, et voilà pourquoi Sigognac n’est pas ridicule quand il parle de forêts magiques qu’il est prêt à traverser, de dragons qu’il va combattre, de géants qu’il saura fendre du « crâne à la ceinture ». Comme le français de son temps, il a lu l’Amadis de Gaulle, il a rêvé les prouesses de l’Espandlion. Ce n’est pas par goût de l’emphase qu’il évoque les paladins. C’est parce qu’un gentilhomme digne de ce nom se doit de rivaliser avec eux en folles prouesses.. »
" Admirable siècle ! " écrit encore Gautier dans ses Grotesques
" […] Le sang et le vin coulent à flots, on s'engueule en excellent latin, on se fait brûler vif. "
Et encore : « c’était le temps des balcons escaladés (…) de cette galanterie espagnole grave et folle à la fois, dévouée jusqu’à la niaiserie, ardente jusqu’à la férocité..., des sonnets et des petits vers, et des grands coups d'épée, et des grandes rasades et du jeu effréné (…) ; quelqu'un vous regarde, un duel ; quelqu'un ne vous regarde pas, encore un duel. "
Le moderne aura tôt fait de sourire à l’évocation de ces idéaux chevaleresques que Léon Bloy, répondant à une enquête sur le fameux roman de Cervantes, Don Quichotte, défend contre le triste bon sens des esprits rabougris…
« Ce livre trop fameux m’amusa, quand j’avais 16 ou 18 ans. Plus tard il m’ennuya et me révolta. Je ne peux souffrir que les grandes choses soient tournées en dérision et la chevalerie est assurément une de ces grandes choses, l’une des plus belles que les hommes ait jamais vues (..) S’il n’y avait que le pauvre chevalier de la Triste Figure, on pourrait faire crédit à sa folie, mais Sancho est intolérable. L’appétit brutal continuellement, systématiquement, victorieusement opposé au Rêve, le ventre ayant toujours raison contre l’Enthousiasme, et le gros rire de la multitude à la face douloureuse de la Poésie, voilà ce qui ne peut être supporté.. » ( Avril 1915 )
Mais revenons à nos trois (quatre) mousquetaires. Le titre du roman suscite à lui seul des idées de jeunesse, de fierté, de galanterie, d’insouciance et d’héroïsme.
D’amitié aussi :
« La vie des quatre jeunes gens était devenue commune ; d'Artagnan, qui n'avait aucune habitude, puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui, prit aussitôt les habitudes de ses amis.
On se levait vers huit heures en hiver, vers six heures en été, et l'on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez M. de Tréville. D'Artagnan, bien qu'il ne fût pas mousquetaire, en faisait le service avec une ponctualité touchante : il était toujours de garde, parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses trois amis qui montait la sienne. On le connaissait à l'hôtel des mousquetaires, et chacun le tenait pour un bon camarade ; M. de Tréville, qui l'avait apprécié du premier coup d'oeil, et qui lui portait une véritable affection, ne cessait de le recommander au roi.
De leur côté, les trois mousquetaires aimaient fort leur jeune camarade. L'amitié qui unissait ces quatre hommes, et le besoin de se voir trois ou quatre fois par jour, soit pour duel, soit pour affaires, soit pour plaisir, les faisaient sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres ; et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice, ou de la rue du Vieux-Colombier au Luxembourg »
[…] Cependant les quarante pistoles du roi Louis XIII, ainsi que toutes les choses de ce monde, après avoir eu un commencement avaient eu une fin, et depuis cette fin nos quatre compagnons étaient tombés dans la gêne. D'abord Athos avait soutenu pendant quelque temps l'association de ses propres deniers. Porthos lui avait succédé, et, grâce à une de ces disparitions auxquelles on était habitué, il avait pendant près de quinze jours encore subvenu aux besoins de tout le monde ; enfin était arrivé le tour d'Aramis, qui s'était exécuté de bonne grâce, et qui était parvenu, disait-il, en vendant ses livres de théologie, à se procurer quelques pistoles.
On eut alors, comme d'habitude, recours à M. de Tréville, qui fit quelques avances sur la solde; mais ces avances ne pouvaient conduire bien loin trois mousquetaires qui avaient déjà force comptes arriérés, et un garde qui n'en avait pas encore.
Enfin, quand on vit qu'on allait manquer tout à fait, on rassembla par un dernier effort huit ou dix pistoles que Porthos joua. Malheureusement, il était dans une mauvaise veine : il perdit tout, plus vingt-cinq pistoles sur parole.
Alors la gêne devint de la détresse ; on vit les affamés suivis de leurs laquais courir les quais et les corps de garde, ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver ; car, suivant l'avis d'Aramis, on devait dans la prospérité semer des repas à droite et à gauche pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce.
Athos fut invité quatre fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais. Porthos eut six occasions et en fit également jouir ses camarades ; Aramis en eut huit. C'était un homme, comme on a déjà pu s'en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne.
Quant à d'Artagnan, qui ne connaissait encore personne dans la capitale, il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays (sic), et un dîner chez un cornette des gardes. Il mena son armée chez le prêtre, auquel on dévora sa provision de deux mois, et chez le cornette, qui fit des merveilles ; mais, comme le disait Planchet, on ne mange toujours qu'une fois, même quand on mange beaucoup.
D'Artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi, car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas, à offrir à ses compagnons en échange des festins que s'étaient procurés Athos, Porthos et Aramis. Il se croyait à charge à la société, oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant un mois, et son esprit préoccupé se mit à travailler activement. Il réfléchit que cette coalition de quatre hommes jeunes, braves, entreprenants et actifs devait avoir un autre but que des promenades déhanchées, des leçons d'escrime et des lazzi plus ou moins spirituels.
En effet, quatre hommes comme eux, quatre hommes dévoués les uns aux autres depuis la bourse jusqu'à la vie, quatre hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun ; quatre bras menaçant les quatre points cardinaux ou se tournant vers un seul point, devaient inévitablement, soit souterrainement, soit au jour, soit par la mine, soit par la tranchée, soit par la ruse, soit par la force, s'ouvrir un chemin vers le but qu'ils voulaient atteindre, si bien défendu ou si éloigné qu'il fût »
La galanterie :
Le roman de Dumas donne une idée des mœurs qui régnaient au début du XVIIeme siècle, « ce temps de facile morale ». L’idylle ébauchée du duc de Buckingham avec la reine de France est à ce titre significative : « D’Artagnan regarda avec stupéfaction cet homme qui mettait le pouvoir illimité dont il était revêtu par la confiance d’un roi au service de ses amours. Buckingham vit à l’expression du visage du jeune homme, ce qui se passait dans sa pensée, et il sourit : « Oui dit-il, c’est qu’Anne d’Autriche est ma véritable reine ; sur un mot d’elle je trahirais mon pays, je trahirais mon roi, je trahirais mon Dieu. Elle m’a demandé de ne point envoyer aux protestants de la Rochelle le secours que je leur avais promis, et je l’ai fait. Je manquais à ma parole mais qu’importe ! J’obéissais à mon désir, n’ai-je point été grandement payé de mon obéissance, dites ? Car c’est à cette obéissance que je dois son portrait… »
Ou encore l’amourette de D’Artagnan avec Constance de Bonacieux, la femme de chambre de la reine :
« A quoi pensait d'Artagnan, qu'il s'écartait ainsi de sa route, regardant les étoiles du ciel, et tantôt soupirant, tantôt souriant ?
Il pensait à Mme Bonacieux. Pour un apprenti mousquetaire, la jeune femme était presque une idéalité amoureuse. Jolie, mystérieuse, initiée à presque tous les secrets de cour, qui reflétaient tant de charmante gravité sur ses traits gracieux, elle était soupçonnée de n'être pas insensible, ce qui est un attrait irrésistible pour les amants novices ; de plus, d'Artagnan l'avait délivrée des mains de ces démons qui voulaient la fouiller et la maltraiter, et cet important service avait établi entre elle et lui un de ces sentiments de reconnaissance qui prennent si facilement un plus tendre caractère.
D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accosté par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelque billet de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. Nous avons dit que les jeunes cavaliers recevaient sans honte de leur roi ; ajoutons qu'en ce temps de facile morale, ils n'avaient pas plus de vergogne à l'endroit de leurs maîtresses, et que celles-ci leur laissaient presque toujours de précieux et durables souvenirs, comme si elles eussent essayé de conquérir la fragilité de leurs sentiments par la solidité de leurs dons.
On faisait alors son chemin par les femmes, sans en rougir. Celles qui n'étaient que belles donnaient leur beauté, et de là vient sans doute le proverbe, que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Celles qui étaient riches donnaient en outre une partie de leur argent, et l'on pourrait citer bon nombre de héros de cette galante époque qui n'eussent gagné ni leurs éperons d'abord, ni leurs batailles ensuite, sans la bourse plus ou moins garnie que leur maîtresse attachait à l'arçon de leur selle (…)
Mais, disons-le, pour le moment d'Artagnan était mû d'un sentiment plus noble et plus désintéressé. Le mercier lui avait dit qu'il était riche ; le jeune homme avait pu deviner qu'avec un niais comme l'était M. Bonacieux, ce devait être la femme qui tenait la clef de la bourse. Mais tout cela n'avait influé en rien sur le sentiment produit par la vue de Mme Bonacieux, et l'intérêt était resté à peu près étranger à ce commencement d'amour qui en avait été la suite. Nous disons : à peu près, car l'idée qu'une jeune femme, belle, gracieuse, spirituelle, et riche en même temps, n'ôte rien à ce commencement d'amour, et tout au contraire le corrobore.
Il y a dans l'aisance une foule de soins et de caprices aristocratiques qui vont bien à la beauté. Un bas fin et blanc, une robe de soie, une guimpe de dentelle, un joli soulier au pied, un frais ruban sur la tête, ne font point jolie une femme laide, mais font belle une femme jolie, sans compter les mains qui gagnent à tout cela ; les mains, chez les femmes surtout, ont besoin de rester oisives pour rester belles.
Puis d'Artagnan, comme le sait bien le lecteur, auquel nous n'avons pas caché l'état de sa fortune, d'Artagnan n'était pas un millionnaire ; il espérait bien le devenir un jour, mais le temps qu'il se fixait lui-même pour cet heureux changement était assez éloigné. En attendant, quel désespoir que de voir une femme qu'on aime désirer ces mille riens dont les femmes composent leur bonheur, et de ne pouvoir lui donner ces mille riens ! Au moins, quand la femme est riche et que l'amant ne l'est pas, ce qu'il ne peut lui offrir elle se l'offre elle-même ; et quoique ce soit ordinairement avec l'argent du mari qu'elle se passe cette jouissance, il est rare que ce soit à lui qu'en revienne la reconnaissance »
Le récit se déroule au temps de Louis XIII, où les intrigues politiques et les intrigues galantes s’enchevêtraient si bien les unes aux autres. C’est aussi à cette époque que se situe l’action du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, qui lui aussi a entrepris de faire revivre dans son roman l’esprit de ce temps. Comme le souligne le critique Antoine Adam, « Gautier a vu avec beaucoup de netteté que les raffinés et les bretteurs sont les types qui occupent le devant de la scène de cette époque. D’un côté l’homme d’épée qui ne songe qu’à se battre sous prétexte du point d’honneur. De l’autre l’habitué des salons, avec son goût pour les recherches d’esprit, pour les raffinements de langage, pour les subtilités de sentiment et d’expression que les historiens ont appelés plus tard la préciosité. Il ne s’agit pas ici de simples tableaux pittoresques évoquant le France de Louis XIII…Gautier sait que le Français est alors nourri de la lecture des romans de chevalerie, et voilà pourquoi Sigognac n’est pas ridicule quand il parle de forêts magiques qu’il est prêt à traverser, de dragons qu’il va combattre, de géants qu’il saura fendre du « crâne à la ceinture ». Comme le français de son temps, il a lu l’Amadis de Gaulle, il a rêvé les prouesses de l’Espandlion. Ce n’est pas par goût de l’emphase qu’il évoque les paladins. C’est parce qu’un gentilhomme digne de ce nom se doit de rivaliser avec eux en folles prouesses.. »
" Admirable siècle ! " écrit encore Gautier dans ses Grotesques
" […] Le sang et le vin coulent à flots, on s'engueule en excellent latin, on se fait brûler vif. "
Et encore : « c’était le temps des balcons escaladés (…) de cette galanterie espagnole grave et folle à la fois, dévouée jusqu’à la niaiserie, ardente jusqu’à la férocité..., des sonnets et des petits vers, et des grands coups d'épée, et des grandes rasades et du jeu effréné (…) ; quelqu'un vous regarde, un duel ; quelqu'un ne vous regarde pas, encore un duel. "
Le moderne aura tôt fait de sourire à l’évocation de ces idéaux chevaleresques que Léon Bloy, répondant à une enquête sur le fameux roman de Cervantes, Don Quichotte, défend contre le triste bon sens des esprits rabougris…
« Ce livre trop fameux m’amusa, quand j’avais 16 ou 18 ans. Plus tard il m’ennuya et me révolta. Je ne peux souffrir que les grandes choses soient tournées en dérision et la chevalerie est assurément une de ces grandes choses, l’une des plus belles que les hommes ait jamais vues (..) S’il n’y avait que le pauvre chevalier de la Triste Figure, on pourrait faire crédit à sa folie, mais Sancho est intolérable. L’appétit brutal continuellement, systématiquement, victorieusement opposé au Rêve, le ventre ayant toujours raison contre l’Enthousiasme, et le gros rire de la multitude à la face douloureuse de la Poésie, voilà ce qui ne peut être supporté.. » ( Avril 1915 )
Mais revenons à nos trois (quatre) mousquetaires. Le titre du roman suscite à lui seul des idées de jeunesse, de fierté, de galanterie, d’insouciance et d’héroïsme.
D’amitié aussi :
« La vie des quatre jeunes gens était devenue commune ; d'Artagnan, qui n'avait aucune habitude, puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui, prit aussitôt les habitudes de ses amis.
On se levait vers huit heures en hiver, vers six heures en été, et l'on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez M. de Tréville. D'Artagnan, bien qu'il ne fût pas mousquetaire, en faisait le service avec une ponctualité touchante : il était toujours de garde, parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses trois amis qui montait la sienne. On le connaissait à l'hôtel des mousquetaires, et chacun le tenait pour un bon camarade ; M. de Tréville, qui l'avait apprécié du premier coup d'oeil, et qui lui portait une véritable affection, ne cessait de le recommander au roi.
De leur côté, les trois mousquetaires aimaient fort leur jeune camarade. L'amitié qui unissait ces quatre hommes, et le besoin de se voir trois ou quatre fois par jour, soit pour duel, soit pour affaires, soit pour plaisir, les faisaient sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres ; et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice, ou de la rue du Vieux-Colombier au Luxembourg »
[…] Cependant les quarante pistoles du roi Louis XIII, ainsi que toutes les choses de ce monde, après avoir eu un commencement avaient eu une fin, et depuis cette fin nos quatre compagnons étaient tombés dans la gêne. D'abord Athos avait soutenu pendant quelque temps l'association de ses propres deniers. Porthos lui avait succédé, et, grâce à une de ces disparitions auxquelles on était habitué, il avait pendant près de quinze jours encore subvenu aux besoins de tout le monde ; enfin était arrivé le tour d'Aramis, qui s'était exécuté de bonne grâce, et qui était parvenu, disait-il, en vendant ses livres de théologie, à se procurer quelques pistoles.
On eut alors, comme d'habitude, recours à M. de Tréville, qui fit quelques avances sur la solde; mais ces avances ne pouvaient conduire bien loin trois mousquetaires qui avaient déjà force comptes arriérés, et un garde qui n'en avait pas encore.
Enfin, quand on vit qu'on allait manquer tout à fait, on rassembla par un dernier effort huit ou dix pistoles que Porthos joua. Malheureusement, il était dans une mauvaise veine : il perdit tout, plus vingt-cinq pistoles sur parole.
Alors la gêne devint de la détresse ; on vit les affamés suivis de leurs laquais courir les quais et les corps de garde, ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver ; car, suivant l'avis d'Aramis, on devait dans la prospérité semer des repas à droite et à gauche pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce.
Athos fut invité quatre fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais. Porthos eut six occasions et en fit également jouir ses camarades ; Aramis en eut huit. C'était un homme, comme on a déjà pu s'en apercevoir, qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne.
Quant à d'Artagnan, qui ne connaissait encore personne dans la capitale, il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays (sic), et un dîner chez un cornette des gardes. Il mena son armée chez le prêtre, auquel on dévora sa provision de deux mois, et chez le cornette, qui fit des merveilles ; mais, comme le disait Planchet, on ne mange toujours qu'une fois, même quand on mange beaucoup.
D'Artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi, car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas, à offrir à ses compagnons en échange des festins que s'étaient procurés Athos, Porthos et Aramis. Il se croyait à charge à la société, oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant un mois, et son esprit préoccupé se mit à travailler activement. Il réfléchit que cette coalition de quatre hommes jeunes, braves, entreprenants et actifs devait avoir un autre but que des promenades déhanchées, des leçons d'escrime et des lazzi plus ou moins spirituels.
En effet, quatre hommes comme eux, quatre hommes dévoués les uns aux autres depuis la bourse jusqu'à la vie, quatre hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun ; quatre bras menaçant les quatre points cardinaux ou se tournant vers un seul point, devaient inévitablement, soit souterrainement, soit au jour, soit par la mine, soit par la tranchée, soit par la ruse, soit par la force, s'ouvrir un chemin vers le but qu'ils voulaient atteindre, si bien défendu ou si éloigné qu'il fût »
La galanterie :
Le roman de Dumas donne une idée des mœurs qui régnaient au début du XVIIeme siècle, « ce temps de facile morale ». L’idylle ébauchée du duc de Buckingham avec la reine de France est à ce titre significative : « D’Artagnan regarda avec stupéfaction cet homme qui mettait le pouvoir illimité dont il était revêtu par la confiance d’un roi au service de ses amours. Buckingham vit à l’expression du visage du jeune homme, ce qui se passait dans sa pensée, et il sourit : « Oui dit-il, c’est qu’Anne d’Autriche est ma véritable reine ; sur un mot d’elle je trahirais mon pays, je trahirais mon roi, je trahirais mon Dieu. Elle m’a demandé de ne point envoyer aux protestants de la Rochelle le secours que je leur avais promis, et je l’ai fait. Je manquais à ma parole mais qu’importe ! J’obéissais à mon désir, n’ai-je point été grandement payé de mon obéissance, dites ? Car c’est à cette obéissance que je dois son portrait… »
Ou encore l’amourette de D’Artagnan avec Constance de Bonacieux, la femme de chambre de la reine :
« A quoi pensait d'Artagnan, qu'il s'écartait ainsi de sa route, regardant les étoiles du ciel, et tantôt soupirant, tantôt souriant ?
Il pensait à Mme Bonacieux. Pour un apprenti mousquetaire, la jeune femme était presque une idéalité amoureuse. Jolie, mystérieuse, initiée à presque tous les secrets de cour, qui reflétaient tant de charmante gravité sur ses traits gracieux, elle était soupçonnée de n'être pas insensible, ce qui est un attrait irrésistible pour les amants novices ; de plus, d'Artagnan l'avait délivrée des mains de ces démons qui voulaient la fouiller et la maltraiter, et cet important service avait établi entre elle et lui un de ces sentiments de reconnaissance qui prennent si facilement un plus tendre caractère.
D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accosté par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelque billet de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. Nous avons dit que les jeunes cavaliers recevaient sans honte de leur roi ; ajoutons qu'en ce temps de facile morale, ils n'avaient pas plus de vergogne à l'endroit de leurs maîtresses, et que celles-ci leur laissaient presque toujours de précieux et durables souvenirs, comme si elles eussent essayé de conquérir la fragilité de leurs sentiments par la solidité de leurs dons.
On faisait alors son chemin par les femmes, sans en rougir. Celles qui n'étaient que belles donnaient leur beauté, et de là vient sans doute le proverbe, que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Celles qui étaient riches donnaient en outre une partie de leur argent, et l'on pourrait citer bon nombre de héros de cette galante époque qui n'eussent gagné ni leurs éperons d'abord, ni leurs batailles ensuite, sans la bourse plus ou moins garnie que leur maîtresse attachait à l'arçon de leur selle (…)
Mais, disons-le, pour le moment d'Artagnan était mû d'un sentiment plus noble et plus désintéressé. Le mercier lui avait dit qu'il était riche ; le jeune homme avait pu deviner qu'avec un niais comme l'était M. Bonacieux, ce devait être la femme qui tenait la clef de la bourse. Mais tout cela n'avait influé en rien sur le sentiment produit par la vue de Mme Bonacieux, et l'intérêt était resté à peu près étranger à ce commencement d'amour qui en avait été la suite. Nous disons : à peu près, car l'idée qu'une jeune femme, belle, gracieuse, spirituelle, et riche en même temps, n'ôte rien à ce commencement d'amour, et tout au contraire le corrobore.
Il y a dans l'aisance une foule de soins et de caprices aristocratiques qui vont bien à la beauté. Un bas fin et blanc, une robe de soie, une guimpe de dentelle, un joli soulier au pied, un frais ruban sur la tête, ne font point jolie une femme laide, mais font belle une femme jolie, sans compter les mains qui gagnent à tout cela ; les mains, chez les femmes surtout, ont besoin de rester oisives pour rester belles.
Puis d'Artagnan, comme le sait bien le lecteur, auquel nous n'avons pas caché l'état de sa fortune, d'Artagnan n'était pas un millionnaire ; il espérait bien le devenir un jour, mais le temps qu'il se fixait lui-même pour cet heureux changement était assez éloigné. En attendant, quel désespoir que de voir une femme qu'on aime désirer ces mille riens dont les femmes composent leur bonheur, et de ne pouvoir lui donner ces mille riens ! Au moins, quand la femme est riche et que l'amant ne l'est pas, ce qu'il ne peut lui offrir elle se l'offre elle-même ; et quoique ce soit ordinairement avec l'argent du mari qu'elle se passe cette jouissance, il est rare que ce soit à lui qu'en revienne la reconnaissance »






 Judas Iscarioth, l’apôtre félon (Serge Boulgakov)
Judas Iscarioth, l’apôtre félon (Serge Boulgakov)