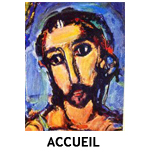Le meilleur de la rentrée, de l’année, de la décennie
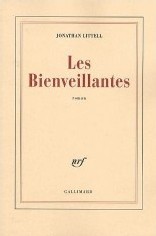
Il n’est pas besoin de lire les 600 ou 700 romans de la «rentrée littéraire» pour voir immédiatement que Les Bienveillantes, de Jonathan Littell, est de loin le meilleur d’entre eux et, j’ose le dire, le premier grand roman français du XXIème siècle, l’homologue de ce que furent il y a cent ans La porte étroite, ou Du côté de chez Swann.
Comme eux, il fait entendre un son nouveau, que l’on n’aurait pas su déduire des romans qui l’ont précédé ; comme eux il marque profondément et durablement ; il présente d’emblée un auteur, un style, un thème qui, bien que rebattu, dégage une puissante impression de nouveau. Les débuts de Jean Rouaud il y a quinze ans font pâle figure en regard.
Comme eux, il fait entendre un son nouveau, que l’on n’aurait pas su déduire des romans qui l’ont précédé ; comme eux il marque profondément et durablement ; il présente d’emblée un auteur, un style, un thème qui, bien que rebattu, dégage une puissante impression de nouveau. Les débuts de Jean Rouaud il y a quinze ans font pâle figure en regard.
L’objet du roman : le mal
Aura-t-il fallu pour cela plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel ? Oui et non. Oui car le sujet des Bienveillantes est résolument métaphysique ; non car la manière de l’aborder, de l’exposer, n’est en rien métaphysique.
Les recensions ont assez dit l’extérieur du livre : ce sont les mémoires d’un officier SS, l’Obersturmbannfüher Dr. Maximilian Aue, de père allemand et de mère française, jumeau d’une sœur, et qui fait beaucoup de vilaines choses.
Allons droit au but : l’objet du roman, c’est le mal, son effet sur le personnage principal et sur le monde qui l’entoure. Par instant, Les bienveillantes sont aussi un roman historique, un roman policier, un roman symbolique, un récit onirique… mais c’est la problématique du mal qui reste centrale.
Le Dr. Aue est bien placé pour le voir à l’œuvre, le mal, puisqu’il travaille dans un commando SS chargé d’éliminer, derrière le front de l’est, juifs, communistes, tout ce qui lui tombe sous la main. Puis il est envoyé à Stalingrad, d’où il se tire miraculeusement ; et enfin il passe la dernière partie de la guerre entre Berlin et Auschwitz.
Les recensions ont assez dit l’extérieur du livre : ce sont les mémoires d’un officier SS, l’Obersturmbannfüher Dr. Maximilian Aue, de père allemand et de mère française, jumeau d’une sœur, et qui fait beaucoup de vilaines choses.
Allons droit au but : l’objet du roman, c’est le mal, son effet sur le personnage principal et sur le monde qui l’entoure. Par instant, Les bienveillantes sont aussi un roman historique, un roman policier, un roman symbolique, un récit onirique… mais c’est la problématique du mal qui reste centrale.
Le Dr. Aue est bien placé pour le voir à l’œuvre, le mal, puisqu’il travaille dans un commando SS chargé d’éliminer, derrière le front de l’est, juifs, communistes, tout ce qui lui tombe sous la main. Puis il est envoyé à Stalingrad, d’où il se tire miraculeusement ; et enfin il passe la dernière partie de la guerre entre Berlin et Auschwitz.
Le mal bénin
La première caractéristique du mal, illustrée tout au long de ces 900 pages, c’est sa banalité, et sa propension à se développer sur les faiblesses des bons. Littell n’a pas commis l’erreur de peindre ses SS comme des ogres buvant le sang des enfants juifs, ce qui est après tout l’image qu’on en a dans la société contemporaine. Comme de nombreux autres, le Dr. Aue est humain, cultivé. Il a un travail à faire, un sale travail – mais cela n’en fait pas un sadique pour autant. On aimerait le voir sanguinaire, violent, fanatique, mais non. Il s’attache à «humaniser» des détails de la mission d’extermination des SS sans jamais remettre en cause le but principal, sans même sembler voir qu’il est mauvais. Il s’inquiètera ainsi des effets que peuvent avoir les exécutions menées par centaines quotidiennes sur la santé mentale des troupes, sans contester la nécessité d’une élimination totale des juifs. Il veut faire baisser le nombre de suicides dans les rangs de l’armée, s’insurge contre la pratique d’exécution à deux tireurs seulement (cela ne «dilue» pas assez la responsabilité des soldats), contre certains soldats sadiques, contre l’ordre de Hitler d’exécuter aussi femmes et enfants.
Mais Aue n’est pas un carriériste. C’est un juriste qui s’est retrouvé dans la SS pour échapper à un procès de mœurs (les mœurs d’Aue mériteraient un livre à part), et qui fait un travail auquel il ne se destinait pas, avec conscience professionnelle : rapports soignés, enquêtes sur le moral des troupes. A Auschwitz il s’insurgera de même contre la condition des prisonniers, aux rations insuffisantes, dont une part était encore détournée par un système de corruption. Il tentera de «coincer» les corrompus dans la SS, sans succès. Il tentera d’améliorer l’ordinaire des prisonniers des camps, pensant que leur force de travail devait être mieux exploitée mais ne remettant jamais en cause le fait qu’ils devaient mourir. Il le fera de manière très bureaucratique, d’ailleurs, en établissant un système de rationnement du surplus selon la force des prisonniers. Pour tout dire, Aue fait de l’audit et du contrôle de gestion ; il planifie, essaie de faire avec ce qu’il a sous la main ; c’est un «bon petit soldat» qui n’entend rien à la politique, s’indigne que Höss habille ses enfants avec des vêtements de juifs gazés, ne comprend pas les demi-mots et manque toutes les chances d’avancement par… candeur.
C’est ainsi qu’il se retrouve à Stalingrad sans réellement comprendre pourquoi ; c’est aussi pour cela qu’il croise sans arrêts la figure de Thomas, le supérieur qui l’a enrôlé, qui le protège et qui lui sauve la vie. Divinité bienveillante, Thomas est ce que Aue pourrait être s’il se prenait en main : officier carriériste, coureur, détaché. J’écris «bienveillante» à dessein car le roman est traversé de ces personnages allégoriques qui forcent Aue à se positionner, à prendre parti. Les deux policiers, Clemens et Weser, enquêtent sur la mort de sa mère et de son beau-père, à Antibes, alors qu’il était présent… mais sans se souvenir de rien. Il y a également deux mystérieux jumeaux, fils de sa sœur dans on ne sait trop quelle affreuse union. Tour à tour erinnyes ou euménides (d’où ce titre des «bienveillantes»), ce sont les personnages qui dirigent la vie de Aue durant tout le roman… jusqu’à la fin où il échange ce fardeau pour un autre plus classique.
Mais Aue n’est pas un carriériste. C’est un juriste qui s’est retrouvé dans la SS pour échapper à un procès de mœurs (les mœurs d’Aue mériteraient un livre à part), et qui fait un travail auquel il ne se destinait pas, avec conscience professionnelle : rapports soignés, enquêtes sur le moral des troupes. A Auschwitz il s’insurgera de même contre la condition des prisonniers, aux rations insuffisantes, dont une part était encore détournée par un système de corruption. Il tentera de «coincer» les corrompus dans la SS, sans succès. Il tentera d’améliorer l’ordinaire des prisonniers des camps, pensant que leur force de travail devait être mieux exploitée mais ne remettant jamais en cause le fait qu’ils devaient mourir. Il le fera de manière très bureaucratique, d’ailleurs, en établissant un système de rationnement du surplus selon la force des prisonniers. Pour tout dire, Aue fait de l’audit et du contrôle de gestion ; il planifie, essaie de faire avec ce qu’il a sous la main ; c’est un «bon petit soldat» qui n’entend rien à la politique, s’indigne que Höss habille ses enfants avec des vêtements de juifs gazés, ne comprend pas les demi-mots et manque toutes les chances d’avancement par… candeur.
C’est ainsi qu’il se retrouve à Stalingrad sans réellement comprendre pourquoi ; c’est aussi pour cela qu’il croise sans arrêts la figure de Thomas, le supérieur qui l’a enrôlé, qui le protège et qui lui sauve la vie. Divinité bienveillante, Thomas est ce que Aue pourrait être s’il se prenait en main : officier carriériste, coureur, détaché. J’écris «bienveillante» à dessein car le roman est traversé de ces personnages allégoriques qui forcent Aue à se positionner, à prendre parti. Les deux policiers, Clemens et Weser, enquêtent sur la mort de sa mère et de son beau-père, à Antibes, alors qu’il était présent… mais sans se souvenir de rien. Il y a également deux mystérieux jumeaux, fils de sa sœur dans on ne sait trop quelle affreuse union. Tour à tour erinnyes ou euménides (d’où ce titre des «bienveillantes»), ce sont les personnages qui dirigent la vie de Aue durant tout le roman… jusqu’à la fin où il échange ce fardeau pour un autre plus classique.
Les effets du mal
Le mal, Aue ne le voit pas partout, surtout quand il est énorme, mais il en ressent mystérieursement les effets ; vomissements et diarrhée s’installent avec les exécutions et le ne quittent qu’avec elles. (Le chapitre où cela atteint son point culminant s’appelle «courante». Coïncidence ? Peut être ; les titres des chapitres sont empruntés à la «suite» classique, Gigue, Gavotte, Air etc. L’auteur est trop bon pour que cela ne soit pas un hasard)
Parfois ces symptômes interviennent sans s’annoncer, on ne sait trop pourquoi. C’est qu’Aue ne va pas bien dans sa tête. Homosexuel dans un monde où l’homosexualité est punie de mort, il a de fortes tendances incestueuses qui le poussent vers sa sœur jumelle… et vers des scènes qui empruntent à Georges Bataille, voire au Marquis de Sade et qui sont la raison que nous déconseillons la lecture des Bienveillantes aux esprits impressionnables. Entre exécutions, coliques et tableaux de bord de gestion, Aue préserve, grâce à l’art, à la littérature surtout, un semblant d’humanité, qui ne se réveille plus que devant un livre. Tout le reste, tout le sens moral conscient est anesthésié ; c’est le corps qui est le dernier à garder un sens moral, qui en chie au sens propre. Le mal est annoncé par la prestilence, par la saleté. Les impressions animales l’atteignent encore ; la garde d’honneur déployée par Frank, l’administrateur de Reich en Pologne, le fascine par sa barbarie.
Parfois ces symptômes interviennent sans s’annoncer, on ne sait trop pourquoi. C’est qu’Aue ne va pas bien dans sa tête. Homosexuel dans un monde où l’homosexualité est punie de mort, il a de fortes tendances incestueuses qui le poussent vers sa sœur jumelle… et vers des scènes qui empruntent à Georges Bataille, voire au Marquis de Sade et qui sont la raison que nous déconseillons la lecture des Bienveillantes aux esprits impressionnables. Entre exécutions, coliques et tableaux de bord de gestion, Aue préserve, grâce à l’art, à la littérature surtout, un semblant d’humanité, qui ne se réveille plus que devant un livre. Tout le reste, tout le sens moral conscient est anesthésié ; c’est le corps qui est le dernier à garder un sens moral, qui en chie au sens propre. Le mal est annoncé par la prestilence, par la saleté. Les impressions animales l’atteignent encore ; la garde d’honneur déployée par Frank, l’administrateur de Reich en Pologne, le fascine par sa barbarie.
Le mal : banal, seulement ?
Un critique a pu parler de «banalité du mal» ; je ne crois pas que cela soit aussi simple. Il y a banalité parce qu’il y a extraordinarité ; plusieurs personnages insistent pour dire que l’élimination physique des Juifs est nécessaire parce qu’on ne peut pas faire mieux à l’heure actuelle (pas assez de moyens pour les déporter, en somme). J’ai plutôt l’impression que Les bienveillantes rendent compte de l’invisibilité du mal : on ne le voit pas, ou plus ; ou alors on le voit là où il n’est pas. Il y a pire : le mal est dissimulé par la chaîne des responsabilités. Chacun n’en fait qu’un tout petit peu (à quelques exceptions près). Aue pourra ainsi assister au processus de « triage » à l’entrée d’Auschwitz sans mentionner une seule fois que les triés étaient gazés sur le champ. C’est là une des choses que nous avons le plus de mal à accepter au sujet du mal : tous les maillons de la chaîne semblent bénins, et la responsabilité peut rarement être accablante. Aue est persuadé que la SS sera le bouc émissaire, paiera pour les atrocités des sadiques en son sein, pour celles de la Wehrmacht… il n’est pas persuadé du tout d’être le dépositaire d’une énorme reponsabilité morale. Banalité, donc, mais aussi invisbilité, irresponsabilité, bénignité, impunité peut-être, tel est le mal peint par Littell. Je le crois très réaliste et c’est peut être pour cela que certains auront du mal à l’accepter. Après tout, le SS-boucher est une figure plus rassurante.
La folie
Par moments, Aue devient complètement fou. Une blessure, à Stalingrad, l’envoie dans plusieurs pages délirantes qui ne sont pas sans évoquer de semblables passages dans Mort à crédit. De même, alors que Berlin va tomber, que le pays est la proie des Russes, Aue fuit dans la maison désertée de sa sœur et là, il oublie tout, le temps, la guerre, l’espace, le besoin de se nourrir et il vit quelques jours dans une bulle, suspendu dans le souvenir incestueux de sa sœur. C’est sans doute le plus beau passage du roman, une unité de lieu, un temps suspendu et du cul, du cul, du cul… on dirait une parodie de Julien Gracq par Sade. Ou le contraire. Immédiatement après, le récit de la fuite à travers les lignes russes, de la rencontre d’une bande d’enfants meurtriers, et de leur conversatation imaginaire avec Hitler, à travers une boîte de conserve et un fil, est à peine moins réussi.
Un semblable accès de folie en fait le meurtrier inconscient de sa mère ; un autre accès de folie lui fait abattre froidement un organiste dans une église, qui «joue du Bach alors que le Reich s’effondre» alors que lui, Aue, n’y tient plus tellement, au Reich. C’est encore un accès de folie hilarant, dans le bunker de Hitler, qui mettra en branle les événements qui lui sauveront sans doute la vie.
Un semblable accès de folie en fait le meurtrier inconscient de sa mère ; un autre accès de folie lui fait abattre froidement un organiste dans une église, qui «joue du Bach alors que le Reich s’effondre» alors que lui, Aue, n’y tient plus tellement, au Reich. C’est encore un accès de folie hilarant, dans le bunker de Hitler, qui mettra en branle les événements qui lui sauveront sans doute la vie.
Le polar, la tragédie, le symbolisme, l’introspection…
Donc, je l’ai dit, il y a du roman policier (les deux flics qui cherchent à lui mettre le meurtre de ses beaux-parents sur le dos), du roman symbolique (les principaux personnages sont autant de divinités qui manipulent la vie de Aue à leur guise), du roman philosophique (une des thèses de Aue est qu’on ne déteste bien que ce qui nous ressemble ; l’application qu’il en fait aux Juifs et aux Allemands ne sera pas du goût de tout le monde). C’est aussi le roman d’une personne qui se débat dans ses propres complexes (l’amour de sa sœur, que rien ne peut remplacer), dans le divertissement pascalien (il trompe l’ennui et la nostalgie de sa sœur en cherchant à capter, dans les exécutions, l’instant précis de la mort, à voir s’il peut saisir l’essence de la mort, une généralité à partir des cas individuels), dans la «world company» (la SS est une multinationale dans laquelle il n’est pas suffisamment arriviste), dans l’expérience physique du mal (qu’il ne reconnait pas).
C’est aussi un roman historique, en ce sens que le substrat du roman, une longue narration un peu bureaucratique, est incroyablement bien et minutieusement documentée. Elle reflète naturellement l’esprit de personnage : been there, done that, qui mentionne les plus grandes horreurs comme des détails. Le talent de l’auteur se mesure à sa capacité à nous faire admettre, presque immédiatement après quelques effets rhétoriques du prologue, la réalité du narrateur. Le Dr. Aue sonne « juste » tout le temps.
C’est aussi un roman historique, en ce sens que le substrat du roman, une longue narration un peu bureaucratique, est incroyablement bien et minutieusement documentée. Elle reflète naturellement l’esprit de personnage : been there, done that, qui mentionne les plus grandes horreurs comme des détails. Le talent de l’auteur se mesure à sa capacité à nous faire admettre, presque immédiatement après quelques effets rhétoriques du prologue, la réalité du narrateur. Le Dr. Aue sonne « juste » tout le temps.
Riche, complet, profond, essentiel… donc bon
C’est à mon avis cette alliance extrêmement réussie de la peinture du mal, de celle d’un homme qui en est l’auteur, qui le tolère mais en est aussi la victime (on ne peut être l’un sans être l’autre, au demeurant), de celle d’une époque, et de la complexité du mal, de l’homme et de l’époque qui fait que Les Bienveillantes, malgré la sécheresse de sa prose, est un roman dont on ne peut sortir avant la dernière page. Aue se libère-t-il des griffes de ses démons ? Oui, en un sens, mais c’est pour reprendre les mêmes que tout le monde et assumer la condition humaine, mortelle, et son autre cortège de fardeaux, énoncés au dernier paragraphe.
Je ne souhaite pas le Goncourt, un peu galvaudé, à Littell mais le Grand Prix de l’Académie Française. Un tel livre a de plain pied sa place dans les manuels de littératures à naître. «Frères humains, laissez-moi vous raconter comment cela s’est passé» est un incipit qu’il faudra connaître. Qu’il n’ait pas le Goncourt en plus serait un déni de justice, au demeurant.
5/5
Je ne souhaite pas le Goncourt, un peu galvaudé, à Littell mais le Grand Prix de l’Académie Française. Un tel livre a de plain pied sa place dans les manuels de littératures à naître. «Frères humains, laissez-moi vous raconter comment cela s’est passé» est un incipit qu’il faudra connaître. Qu’il n’ait pas le Goncourt en plus serait un déni de justice, au demeurant.
5/5






 Jean-Louis Foncine, romancier pour la jeunesse
Jean-Louis Foncine, romancier pour la jeunesse