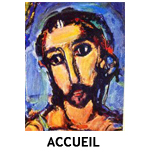La bataille d'Alger est un paradoxe de près de quarante ans. Sorti au milieu des années 60, le film a été aussitôt interdit, et n'a été réellement exhumé qu'il y a quelques mois, profitant du regain d'intérêt national pour la guerre d'Algérie. Pourtant, ce n'était pas un film de circonstance ou de propagande mais une oeuvre d'art, voulue comme telle, et primée notamment d'un lion d'or et trois nominations aux Oscars. C'était également, si l'on en croit certains travaux récents, au premier lieu celui de Marie-Monique Robin, « Escadrons de la mort, l'école française », un film d'instruction, de par son réalisme et son aspect pédagogique. « Projeté au Pentagone en 2003 », dit fourbement la jaquette. On pouvait donc s'attendre, au moment du grand relancement sur Arte, suivi d'une sortie de l'ombre et en double DVD, à voir en « la bataille d'Alger » un film perturbateur et démonstratif.
La vérité est que les intuitions du jury de Venise sont avérées : la « bataille d'Alger » est bien plus qu'un film de propagande ; c'est une oeuvre engagée, parmi les meilleures ; elle évite assez bien la lourdeur ou l'esprit partisan. Naturellement, elle est un peu orientée ; on devine vite que les sympathies du réalisateur, Gilles Pontecorvo, vont au peuple algérien, et qu'il minimise quelques défauts, notamment la division et les règlements de compte entre mouvements nationalistes. Mais dans l'ensemble, un film comme Billy Elliot manipule cent fois plus.
Le style choisi par Pontecorvo est celui du réalisme didactique : son objectif est que le spectateur ait en sortant du cinéma une vision claire, articulée et en images, de ce que furent ces semaines de 1957 ; non comme une accumulation de scènes de guerilla, mais vues d'en haut, du haut de la stratégie de l'état-major français. Le spectateur doit saisir le plan d'ensemble, la stratégie des deux parties.
La partie européenne fait penser à ces Signe de Piste de la même époque où une organisation scoute, victime de son archaïsme, se voit balayer par des jeunes Turcs qui veulent que « ça bouge » ; c'est Crozaguil (Loïc Ervoan), c'est Les Forts et les Purs (Jean-Louis Foncine), c'est Le puits d'El-Hadjar (Dachs), c'est le Signe dans la Pierre (Paul Henrys).
Ce qui était un voeu pieux ou un beau sujet littéraire chez les scouts est une réalité à Alger. L'organisation policière, impuissante à juguler la campagne d'attentats menée par le FLN, cède la place à ceux qui veulent que « ça bouge », les paras d'un colonel qui est comme un mixte de Bigeard et de Massu. Le digne bleu marine droit dans ses bottes fait place à la tenue léopard. Les paras apportent avec eux des méthodes expéditives qui les rendront vainqueurs de la bataille d'Alger. Le film détaille les méthodes, leur raison, et leur prix. Si la victoire est à la clef, le prix de la victoire est inévitablement trop lourd : des opérations de police assumées par l'armée, des opérations de terreur et d'élimination physique, et bien entendu, la torture.
Il était facile, avec un tel propos, de dériver dans un lyrisme vendeur qui aurait acquis au film toute l'intelligentsia germanopratine de l'époque. Ce n'est pas ce qu'a choisi Pontecorvo. En filmant avec une grande économie de moyens, il donne à la « bataille » une allure de documentaire montée dans quelque arrière-cour de la Casbah, avec les moyens du bord ; l'image est granuleuse, le son crachouille, la musique est peu recherchée, souvent à la limite du bruitage. Les acteurs ne semblent pas être des professionnels castés sur leur belle gueule mais des gens qu'on a trouvés dans la rue. Le réalisateur parvient, avec ces éléments peu dégrossis, à faire une oeuvre captivante. Les visages ne sont pas beaux, les personnages ne sont ni bons ni mauvais (le FLN dégomme quiconque ne respecte pas la loi islamique, fut-ce pour un verre de vin), les têtes, souvent filmés en gros plan, rappellent que ce sont des hommes qui se débattent dans une situation qui les dépasse souvent, et que Pontecorvo affecte de filmer comme un reportage (les quatre visages, en gros plan, d'Ali la Pointe et de ses complices, cachés dans le mur !).
Car la situation, en effet, est bien près d'être folle. Les attentats répondent aux coups de main. Les innocents, européens comme algériens, font les frais de la surenchère entre le FLN et les forces de l'ordre. Si la population de la Casbah soutient les insurgés, elle en supporte également les frais ; maisons dynamités par les paras, attentats montés par des européens extrémistes. De même, les victimes européennes sont innocentes ; des jeunes qui s'amusaient dans un dancing, qui se rencontraient dans un café ; le réalisateur semble dire : « tous ceux-là n'ont rien fait de mal ». Et pourtant la folie s'amplifie, jusqu'au moment où les paras prennent le contrôle de la ville, instaurent le couvre-feu et quadrillent la Casbah. Premier pilier de la guerre contre-révolutionnaire. De cette manière, l'armée recense les personnes et sait exactement où trouver qui, le soir venu. Le second pilier de cette guerre nouvelle, c'est le renseignement : un suspect capturé fournit le nom de ses chefs ; il ne reste plus qu'à les arrêter et à recommencer le processus. Une fois la structure du FLN démasquée et éliminée, l'organisation terroriste est morte.
Une autre nouveauté de la guerre est fournie par le soutien que toute la population apporte aux terroristes ; cela revient à considérer tous les habitants comme suspects a priori. Il ne reste plus qu'à appliquer le mécanisme : rafles nocturnes, interrogatoires, représailles jusqu'à ce que l'appareil du FLN soit démantelé.
C'est ici la principale qualité pédagogique du film, qui explique par l'exemple comment la guerre contre-révolutionnaire était menée en ce temps. L'exemple suit d'ailleurs systématiquement le discours théorique tenu par le colonel des paras. Le dynamitage de la cache des quatre derniers meneurs achève ainsi l'opération de retour de l'ordre.
Le prix à payer, c'est bien entendu la torture et les actions contre la population civile. Pontecorvo garde ici un propos très modéré ; le renseignement qui permet de débusquer Ali la Pointe et ses derniers séides encore vivants a été obtenu par la force, c'est évident ; mais on voit une fois que la victime a parlé, que les soldats la réconfortent, lui offrent du café, vont bientôt lui rendre sa liberté. C'est pratiquement St Martin partageant son manteau. On a appris, depuis 1966, que la réalité était encore moins rose, et que les torturés, une fois devenus inutiles, étaient liquidés. Le film fait donc dans l'angélisme, mais pas là où on l'attendait.
On peut aussi lui reprocher un peu de parti pris dans la peinture de l'européen et de l'algérien moyen. Le premier est volontiers agressif : « il faudrait tous les tuer », alors que le second prend souvent les allures d'une victime silencieuse, vieille et en mauvaise santé ; tel le torturé du début du film, tel aussi ce vieux assis sur le trottoir, qui se fait prendre à parti par les français massés sur les balcons, sans raison apparente. Mais, comme nous l'avons dit, les européens aussi souffrent et le film les montre ainsi.
Enfin, il y a la torture, en très petite quantité, peut-être trente secondes en tout, traitée avec une relative bienséance.
Que l'on comprenne bien : le cinéma contemporain raffole des scènes choquantes, souvent dégradantes ; mais il les filme presque exclusivement de manière racoleuse, il les filme en somme comme des scènes choquantes. La seconde saison de « 24 heures », par exemple, ne passe pas un épisode sans interrogatoire musclé, et joue malsainement avec l'argument d'Aussaresses : « s'il faut torturer pour sauver des innocents, allons-y ». Les scénaristes de 24 heures font donc preuve d'une grande imagination, très technologique, et peu réaliste ; il y a des drogues qui font souffrir (la torture commence souvent par une piqure !), des belles trousses d'outils qui font penser au dentiste, des appareillages très design ; le tout est retransmis en videoconférence. Les acteurs sont entraînés à gueuler ; bref, même mon poisson rouge a compris que la torture, ça faisait mal.
Dans la bataille d'Alger, trente secondes silencieuses de torture avec des moyens rudimentaires (celle que décrit Aussaresses), sans hurlements de possédé, sans violonnade ou tutti de cuivres, laissent une impression autrement profonde ; elles sont les trente secondes que la mémoire collective de la France a encore le plus grand mal à supporter. Car les gens filmés sont des vrais gens, et les bourreaux sont des vrais gens aussi ; et que ce que les uns font subir aux autres est tout aussi intolérable que les attentats ou les vengeances aveugles qui parsèment le reste du film. Ces trente secondes disent : « voilà quel était le prix à payer pour gagner la bataille d'Alger : étiez-vous prêt à ratifier ceci ? Auriez-vous fait la même chose à leur place ? »
Bien entendu non, comment pourrait-on accepter, une fois que l'on voit concrètement ce que cela donne ? C'est là le coup de maître du cinéaste : éviter l'esthétisme, éviter un Jack Bauer super-agent du contre espionnage qui grimage et transpire à grosse gouttes et fait « argh » pendant qu'on distille au spectateur des détails qui ménagent un écoeurement calculé : « passez-moi la tenaille 12, Mouloud ». Ou éviter un Jésus de Mel Gibson qui fait aussi argh pendant qu'on essaie sur lui la collection complète des fouets et verges du procurateur de Judée (souple, dur, avec plombs, avec clous, vous m'en direz tant).
Ici, c'est juste un aperçu de vrais gens qui souffrent, là encore comme un reportage ; c'est un peu comme la scène de viol dans Délivrance, maladroite, étrange et en fin de compte insoutenable. C'est le contraire de l'esthétisme ; c'est sale, crasseux, laid, et pourtant les yeux s'écarquillent, le souffle se raccourcit, le coeur bat plus vite ; c'est le coup de maître de Pontecorvo et, nous le pensons, la raison qui a fait sombrer ce film dans l'oubli pendant 40 ans : parce que le pays qui a commandité cela ne veut pas encore le regarder en face (il n'est besoin que de voir comment on voudrait museler Aussaresses alors qu'il est un témoin capital de ces événements).
Voilà donc « la bataille d'Alger », injustement méconnue : un film engagé qui éclaire (et simplifie) les passionnants événements de 1957 ; et qui montre, avec une grande vraisemblance et plus d'honnêteté qu'on pouvait attendre, comment se sont conduits les hommes qui y furent impliqués, soldats ou terroristes, européens ou algériens, innocents ou manipulateurs, bourreaux ou victimes, engagés ou dégagés ; il montre ultimement quels furent le prix, les conditions et les conséquence de la victoire (d'une victoire inutile !) et propose au spectateur de les assumer.
Un site pour en savoir plus. « Surprisingly unbiased », comme ils disent.
La vérité est que les intuitions du jury de Venise sont avérées : la « bataille d'Alger » est bien plus qu'un film de propagande ; c'est une oeuvre engagée, parmi les meilleures ; elle évite assez bien la lourdeur ou l'esprit partisan. Naturellement, elle est un peu orientée ; on devine vite que les sympathies du réalisateur, Gilles Pontecorvo, vont au peuple algérien, et qu'il minimise quelques défauts, notamment la division et les règlements de compte entre mouvements nationalistes. Mais dans l'ensemble, un film comme Billy Elliot manipule cent fois plus.
Le style choisi par Pontecorvo est celui du réalisme didactique : son objectif est que le spectateur ait en sortant du cinéma une vision claire, articulée et en images, de ce que furent ces semaines de 1957 ; non comme une accumulation de scènes de guerilla, mais vues d'en haut, du haut de la stratégie de l'état-major français. Le spectateur doit saisir le plan d'ensemble, la stratégie des deux parties.
La partie européenne fait penser à ces Signe de Piste de la même époque où une organisation scoute, victime de son archaïsme, se voit balayer par des jeunes Turcs qui veulent que « ça bouge » ; c'est Crozaguil (Loïc Ervoan), c'est Les Forts et les Purs (Jean-Louis Foncine), c'est Le puits d'El-Hadjar (Dachs), c'est le Signe dans la Pierre (Paul Henrys).
Ce qui était un voeu pieux ou un beau sujet littéraire chez les scouts est une réalité à Alger. L'organisation policière, impuissante à juguler la campagne d'attentats menée par le FLN, cède la place à ceux qui veulent que « ça bouge », les paras d'un colonel qui est comme un mixte de Bigeard et de Massu. Le digne bleu marine droit dans ses bottes fait place à la tenue léopard. Les paras apportent avec eux des méthodes expéditives qui les rendront vainqueurs de la bataille d'Alger. Le film détaille les méthodes, leur raison, et leur prix. Si la victoire est à la clef, le prix de la victoire est inévitablement trop lourd : des opérations de police assumées par l'armée, des opérations de terreur et d'élimination physique, et bien entendu, la torture.
Il était facile, avec un tel propos, de dériver dans un lyrisme vendeur qui aurait acquis au film toute l'intelligentsia germanopratine de l'époque. Ce n'est pas ce qu'a choisi Pontecorvo. En filmant avec une grande économie de moyens, il donne à la « bataille » une allure de documentaire montée dans quelque arrière-cour de la Casbah, avec les moyens du bord ; l'image est granuleuse, le son crachouille, la musique est peu recherchée, souvent à la limite du bruitage. Les acteurs ne semblent pas être des professionnels castés sur leur belle gueule mais des gens qu'on a trouvés dans la rue. Le réalisateur parvient, avec ces éléments peu dégrossis, à faire une oeuvre captivante. Les visages ne sont pas beaux, les personnages ne sont ni bons ni mauvais (le FLN dégomme quiconque ne respecte pas la loi islamique, fut-ce pour un verre de vin), les têtes, souvent filmés en gros plan, rappellent que ce sont des hommes qui se débattent dans une situation qui les dépasse souvent, et que Pontecorvo affecte de filmer comme un reportage (les quatre visages, en gros plan, d'Ali la Pointe et de ses complices, cachés dans le mur !).
Car la situation, en effet, est bien près d'être folle. Les attentats répondent aux coups de main. Les innocents, européens comme algériens, font les frais de la surenchère entre le FLN et les forces de l'ordre. Si la population de la Casbah soutient les insurgés, elle en supporte également les frais ; maisons dynamités par les paras, attentats montés par des européens extrémistes. De même, les victimes européennes sont innocentes ; des jeunes qui s'amusaient dans un dancing, qui se rencontraient dans un café ; le réalisateur semble dire : « tous ceux-là n'ont rien fait de mal ». Et pourtant la folie s'amplifie, jusqu'au moment où les paras prennent le contrôle de la ville, instaurent le couvre-feu et quadrillent la Casbah. Premier pilier de la guerre contre-révolutionnaire. De cette manière, l'armée recense les personnes et sait exactement où trouver qui, le soir venu. Le second pilier de cette guerre nouvelle, c'est le renseignement : un suspect capturé fournit le nom de ses chefs ; il ne reste plus qu'à les arrêter et à recommencer le processus. Une fois la structure du FLN démasquée et éliminée, l'organisation terroriste est morte.
Une autre nouveauté de la guerre est fournie par le soutien que toute la population apporte aux terroristes ; cela revient à considérer tous les habitants comme suspects a priori. Il ne reste plus qu'à appliquer le mécanisme : rafles nocturnes, interrogatoires, représailles jusqu'à ce que l'appareil du FLN soit démantelé.
C'est ici la principale qualité pédagogique du film, qui explique par l'exemple comment la guerre contre-révolutionnaire était menée en ce temps. L'exemple suit d'ailleurs systématiquement le discours théorique tenu par le colonel des paras. Le dynamitage de la cache des quatre derniers meneurs achève ainsi l'opération de retour de l'ordre.
Le prix à payer, c'est bien entendu la torture et les actions contre la population civile. Pontecorvo garde ici un propos très modéré ; le renseignement qui permet de débusquer Ali la Pointe et ses derniers séides encore vivants a été obtenu par la force, c'est évident ; mais on voit une fois que la victime a parlé, que les soldats la réconfortent, lui offrent du café, vont bientôt lui rendre sa liberté. C'est pratiquement St Martin partageant son manteau. On a appris, depuis 1966, que la réalité était encore moins rose, et que les torturés, une fois devenus inutiles, étaient liquidés. Le film fait donc dans l'angélisme, mais pas là où on l'attendait.
On peut aussi lui reprocher un peu de parti pris dans la peinture de l'européen et de l'algérien moyen. Le premier est volontiers agressif : « il faudrait tous les tuer », alors que le second prend souvent les allures d'une victime silencieuse, vieille et en mauvaise santé ; tel le torturé du début du film, tel aussi ce vieux assis sur le trottoir, qui se fait prendre à parti par les français massés sur les balcons, sans raison apparente. Mais, comme nous l'avons dit, les européens aussi souffrent et le film les montre ainsi.
Enfin, il y a la torture, en très petite quantité, peut-être trente secondes en tout, traitée avec une relative bienséance.
Que l'on comprenne bien : le cinéma contemporain raffole des scènes choquantes, souvent dégradantes ; mais il les filme presque exclusivement de manière racoleuse, il les filme en somme comme des scènes choquantes. La seconde saison de « 24 heures », par exemple, ne passe pas un épisode sans interrogatoire musclé, et joue malsainement avec l'argument d'Aussaresses : « s'il faut torturer pour sauver des innocents, allons-y ». Les scénaristes de 24 heures font donc preuve d'une grande imagination, très technologique, et peu réaliste ; il y a des drogues qui font souffrir (la torture commence souvent par une piqure !), des belles trousses d'outils qui font penser au dentiste, des appareillages très design ; le tout est retransmis en videoconférence. Les acteurs sont entraînés à gueuler ; bref, même mon poisson rouge a compris que la torture, ça faisait mal.
Dans la bataille d'Alger, trente secondes silencieuses de torture avec des moyens rudimentaires (celle que décrit Aussaresses), sans hurlements de possédé, sans violonnade ou tutti de cuivres, laissent une impression autrement profonde ; elles sont les trente secondes que la mémoire collective de la France a encore le plus grand mal à supporter. Car les gens filmés sont des vrais gens, et les bourreaux sont des vrais gens aussi ; et que ce que les uns font subir aux autres est tout aussi intolérable que les attentats ou les vengeances aveugles qui parsèment le reste du film. Ces trente secondes disent : « voilà quel était le prix à payer pour gagner la bataille d'Alger : étiez-vous prêt à ratifier ceci ? Auriez-vous fait la même chose à leur place ? »
Bien entendu non, comment pourrait-on accepter, une fois que l'on voit concrètement ce que cela donne ? C'est là le coup de maître du cinéaste : éviter l'esthétisme, éviter un Jack Bauer super-agent du contre espionnage qui grimage et transpire à grosse gouttes et fait « argh » pendant qu'on distille au spectateur des détails qui ménagent un écoeurement calculé : « passez-moi la tenaille 12, Mouloud ». Ou éviter un Jésus de Mel Gibson qui fait aussi argh pendant qu'on essaie sur lui la collection complète des fouets et verges du procurateur de Judée (souple, dur, avec plombs, avec clous, vous m'en direz tant).
Ici, c'est juste un aperçu de vrais gens qui souffrent, là encore comme un reportage ; c'est un peu comme la scène de viol dans Délivrance, maladroite, étrange et en fin de compte insoutenable. C'est le contraire de l'esthétisme ; c'est sale, crasseux, laid, et pourtant les yeux s'écarquillent, le souffle se raccourcit, le coeur bat plus vite ; c'est le coup de maître de Pontecorvo et, nous le pensons, la raison qui a fait sombrer ce film dans l'oubli pendant 40 ans : parce que le pays qui a commandité cela ne veut pas encore le regarder en face (il n'est besoin que de voir comment on voudrait museler Aussaresses alors qu'il est un témoin capital de ces événements).
Voilà donc « la bataille d'Alger », injustement méconnue : un film engagé qui éclaire (et simplifie) les passionnants événements de 1957 ; et qui montre, avec une grande vraisemblance et plus d'honnêteté qu'on pouvait attendre, comment se sont conduits les hommes qui y furent impliqués, soldats ou terroristes, européens ou algériens, innocents ou manipulateurs, bourreaux ou victimes, engagés ou dégagés ; il montre ultimement quels furent le prix, les conditions et les conséquence de la victoire (d'une victoire inutile !) et propose au spectateur de les assumer.
Un site pour en savoir plus. « Surprisingly unbiased », comme ils disent.






 Les fils de l'homme (recension de Nelly)
Les fils de l'homme (recension de Nelly)