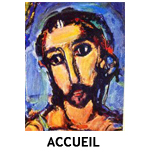Nelly achète le coffret Kubrick

En DVD encore plus récemment : Eyes wide shut. Un film envoûtant, et qui me fait dire, maintenant que je les ai tous vus, qu’il n’y a aucun mauvais film dans l’œuvre de Kubrick. C’est l’histoire d’un couple new-yorkais qui se défait tranquillement. Tom Cruise figure un médecin, Nicole Kidman sa femme. Cette dernière fait part de fantsames adultères à son mari qui, en réaction, cherche à la tromper et aboutit finalement par fraude dans un curieux château ou des personnages masqués se livrent à une orgie. Là, il se trouve démasqué, et doit en assumer les conséquences, qui sont parfois des plus inattendues, et qui l’amèneront – the hard way – à se raccommoder avec sa femme.
Pour moi, Eyes wide shut est un film sur le sexe, et sur les rapports qu’il entretient avec l’amour et la conjugalité. C’est un sujet qui est rarement traité de façon intelligente. Kubrick ici ne généralise jamais mais nous présente un cas particulier sans commentaires, avec sa petite manie de déranger le spectateur. Entre ce que l’on voit (superbe, aussi bien les intérieurs de NY filmés dans la banlieue de Londres que les scènes dans le château) et ce que l’on imagine (qui n’est ni moral ni esthétique), on ne peut pas être tellement à l’aise. Kubrick réussit une fois encore à captiver, à souffler le chaud et le froid en même temps, (l’un des points du film fait implicitement comprendre que, pour avoir un tout petit peu de sexe moral et conjugal, « normal » en somme, il faut passer par une grande dose de sexe pervers, immoral, etc.) à laisser planer le mystère, et même à faire passer Tom Cruise pour un acteur.
(La sublime Nicole Kidman- Alice © 1999 - Warner Brothers)
Stanley Kubrick, The shining. Ou comment prendre une nouvelle inepte de Stephen King, bourrée de clichés et de tics, et d’en tirer un bon film.
Une famille (père, mère, fils) s’installe dans un hôtel des Rocheuses, pour le garder pendant l’hiver, isolé du monde. Déjà les clichés fusent : le gardien précédent a tué sa famille à coup de hache. Et le père, joué par Jack Nicholson, n’a pas l’air tout à fait normal…
Quant au fils, il a des dons préternaturels et des visions (cliché ! cliché !) parce qu’il est un enfant battu (pffff). Malgré tout cela, le film arrive à distiller une ambiance étouffante, jouant beaucoup en cela sur les décors de l’hôtel, qui arrivent à être étranges à eux seuls. La musique de Wendy Carlos mérite aussi d’être signalée.
Pour moi, Eyes wide shut est un film sur le sexe, et sur les rapports qu’il entretient avec l’amour et la conjugalité. C’est un sujet qui est rarement traité de façon intelligente. Kubrick ici ne généralise jamais mais nous présente un cas particulier sans commentaires, avec sa petite manie de déranger le spectateur. Entre ce que l’on voit (superbe, aussi bien les intérieurs de NY filmés dans la banlieue de Londres que les scènes dans le château) et ce que l’on imagine (qui n’est ni moral ni esthétique), on ne peut pas être tellement à l’aise. Kubrick réussit une fois encore à captiver, à souffler le chaud et le froid en même temps, (l’un des points du film fait implicitement comprendre que, pour avoir un tout petit peu de sexe moral et conjugal, « normal » en somme, il faut passer par une grande dose de sexe pervers, immoral, etc.) à laisser planer le mystère, et même à faire passer Tom Cruise pour un acteur.
(La sublime Nicole Kidman- Alice © 1999 - Warner Brothers)
Stanley Kubrick, The shining. Ou comment prendre une nouvelle inepte de Stephen King, bourrée de clichés et de tics, et d’en tirer un bon film.
Une famille (père, mère, fils) s’installe dans un hôtel des Rocheuses, pour le garder pendant l’hiver, isolé du monde. Déjà les clichés fusent : le gardien précédent a tué sa famille à coup de hache. Et le père, joué par Jack Nicholson, n’a pas l’air tout à fait normal…
Quant au fils, il a des dons préternaturels et des visions (cliché ! cliché !) parce qu’il est un enfant battu (pffff). Malgré tout cela, le film arrive à distiller une ambiance étouffante, jouant beaucoup en cela sur les décors de l’hôtel, qui arrivent à être étranges à eux seuls. La musique de Wendy Carlos mérite aussi d’être signalée.
Nelly fait la dame patronnesse et invite des pauvres de sa paroisse à prendre le thé… enfin, presque.
Nous terminons le moment par une promenade dans le parc Monceau. Au moment de payer, je sors mon Amex. C’est incroyable le pouvoir que cette carte peut avoir. *** et *** la palpent, posent des questions. Je les invite ; la tête qu’ils font en lisant la note n’est pas des plus réjouies. *** refuse. Je paye tout quand même ; il me tend un billet de cent francs en dédommagement et ajoute la phrase qui tue : « tu me dois vingt francs ». Encore un qui ne veut pas se laisser bouffer les couilles !
Film : Tanguy, d’Etienne Chatiliez
Tanguy, d’Etienne Chatiliez. Chatiliez has lost it. Son Tanguy part d’un bon concept (le fils à papa surdiplômé qui ne quitte pas le foyer familial, et que ses parents essaient de dégoûter et de faire fuir), d’un texte correct, mais tombe à plat lorsqu’il s’agit des acteurs (qui font leur petit numéro chacun dans leur coin) ou de la réalisation (caméra en mouvements incessants : lors d’un dialogue, on se croirait à Roland Garros, ce sont sans arrêt des allers et retours vers lui, vers elle, vers lui, vers elle…). Le rythme est faible aussi, à part une ou deux explosions hystériques, il ne se passe pas grand chose, cela frise la collection d’anecdotes et l’on a l’impression que ça dure deux heures là où une heure et demi aurait suffi.
Quelques bonnes idées pourtant : s’il dort chez ses parents, il baise aussi chez eux, et les petites amies défilent à la table du petit déjeuner le lendemain. L’une d’elles, japonaise pointilleuse, manque de fondre en larmes lorsqu’elle se send compte que les parents ont tout entendu. LE père (André Dussolier) croit la consoler en ajoutant « vous savez, on a l’habitude », et gaffe encore en la prenant pour une chinoise.
Ceci dit, on a beaucoup de mal à s’imaginer que le personnage-titre a tant de sex-appeal que cela, lui qui est tout en affèterie et en manières. En somme un film français de plus : une bonne idée, un bon texte, le tout ruiné par une mise en scène indigente.
Quelques bonnes idées pourtant : s’il dort chez ses parents, il baise aussi chez eux, et les petites amies défilent à la table du petit déjeuner le lendemain. L’une d’elles, japonaise pointilleuse, manque de fondre en larmes lorsqu’elle se send compte que les parents ont tout entendu. LE père (André Dussolier) croit la consoler en ajoutant « vous savez, on a l’habitude », et gaffe encore en la prenant pour une chinoise.
Ceci dit, on a beaucoup de mal à s’imaginer que le personnage-titre a tant de sex-appeal que cela, lui qui est tout en affèterie et en manières. En somme un film français de plus : une bonne idée, un bon texte, le tout ruiné par une mise en scène indigente.
Film : Battle Royale, de : un Japonais assez vieux et très digne qui n’a pas voulu changer son nom

Battle Royale au cinéma. Dans un futur très contemporain, les adultes ont pris peur des jeunes, et une fois par an, une classe d’un lycée japonais, tirée au sort, est déportée sur une île déserte. Tous doivent s’entretuer jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Koh Lanta avec les fusils mitrailleurs en plus. Cool.
Ne nous demandons surtout pas pourquoi, ni dans quel but. Après une mise en contexte et un briefing sanguinolent (un prof de gym qui zigouille deux ou trois élèves indisciplinés pour la forme : le fantasme de tout le corps enseignant !), il y a 43 élèves et à peu près autant d’assassinats – c’est dire qu’il faut maintenir la cadence. La plupart sont fort violents. Il y a des perles d’humour très noir : deux élèves s’emparent d’un porte-voix et proposent aux autres, embusqués sur l’île, de s’unir et de faire la paix. Bien entendu, ils sont à découvert. Je leur donnais dix secondes pour se faire descendre, il en a fallu vingt. Un peu prévisible mais rigolo. Ce n’est pas sans rappeler, en fait, les speakerines de TVN595, l’émission la moins connue des Nuls. Chacune trouvait une mort violente sur le plateau, mais jamais la même. Ce n’est pas non plus sans rappeler la grande scène de combat de Hot shots 2 avec le nombre de morts en incrustation dans l’image, et des sous titres, « film plus violent que Terminator », « film plus violent que Total recall », « film le plus violent de tous les temps » au fur et à mesure que les cadavres s’entassaient. Pour moi, Battle Royale est en effet plus violent que Total recall, et plus sadique aussi.
Le « développement des personnages », la psychologie, sont totalement absents, et ce ne sont pas les clichés du père du jeune premier, pendu la veille de son entrée au lycée, assénés avec lourdeur, qui vont nous convaincre du contraire.
Autre perle : le gars qui en abat un autre en récitant les formules des racines de l’équation du second degré. Un peu téléphoné, mais ça me parle. Et un must, cinq filles paranoïaques dans une cuisine qui sont assez amies mais s’entretuent quand même – et peu importe qu’elles n’aient jamais touché une arme de leur vie, et qu’elles restent debout après des dizaines de rafales de PM ! Comme je l’ai vu en VO, la scène est ponctuée de hurlement et de glapissements de japonaises du plus bel effet. On dirait deux adolescentes de chez nous se crêpant le chignon pour savoir qui a piqué Jean-Patrick à l’autre, et qui a ragoté sur qui… les grenades en plus !
Par moments, l’esthétique se rapproche plus du manga. Une des scènes d’ouverture, où l’on découvre le survivant d’une opération précédente, une frêle jeune fille au sourire carnassier, est calibrée manga comme c’est pas permis.
Bref, un film où l’on meurt beaucoup, parfois hilarant, mais avec des longueurs.
Ne nous demandons surtout pas pourquoi, ni dans quel but. Après une mise en contexte et un briefing sanguinolent (un prof de gym qui zigouille deux ou trois élèves indisciplinés pour la forme : le fantasme de tout le corps enseignant !), il y a 43 élèves et à peu près autant d’assassinats – c’est dire qu’il faut maintenir la cadence. La plupart sont fort violents. Il y a des perles d’humour très noir : deux élèves s’emparent d’un porte-voix et proposent aux autres, embusqués sur l’île, de s’unir et de faire la paix. Bien entendu, ils sont à découvert. Je leur donnais dix secondes pour se faire descendre, il en a fallu vingt. Un peu prévisible mais rigolo. Ce n’est pas sans rappeler, en fait, les speakerines de TVN595, l’émission la moins connue des Nuls. Chacune trouvait une mort violente sur le plateau, mais jamais la même. Ce n’est pas non plus sans rappeler la grande scène de combat de Hot shots 2 avec le nombre de morts en incrustation dans l’image, et des sous titres, « film plus violent que Terminator », « film plus violent que Total recall », « film le plus violent de tous les temps » au fur et à mesure que les cadavres s’entassaient. Pour moi, Battle Royale est en effet plus violent que Total recall, et plus sadique aussi.
Le « développement des personnages », la psychologie, sont totalement absents, et ce ne sont pas les clichés du père du jeune premier, pendu la veille de son entrée au lycée, assénés avec lourdeur, qui vont nous convaincre du contraire.
Autre perle : le gars qui en abat un autre en récitant les formules des racines de l’équation du second degré. Un peu téléphoné, mais ça me parle. Et un must, cinq filles paranoïaques dans une cuisine qui sont assez amies mais s’entretuent quand même – et peu importe qu’elles n’aient jamais touché une arme de leur vie, et qu’elles restent debout après des dizaines de rafales de PM ! Comme je l’ai vu en VO, la scène est ponctuée de hurlement et de glapissements de japonaises du plus bel effet. On dirait deux adolescentes de chez nous se crêpant le chignon pour savoir qui a piqué Jean-Patrick à l’autre, et qui a ragoté sur qui… les grenades en plus !
Par moments, l’esthétique se rapproche plus du manga. Une des scènes d’ouverture, où l’on découvre le survivant d’une opération précédente, une frêle jeune fille au sourire carnassier, est calibrée manga comme c’est pas permis.
Bref, un film où l’on meurt beaucoup, parfois hilarant, mais avec des longueurs.
Manga : Jin Roh, de… le gars qui fera Avalon plus tard.
Jin-Roh de… Sashimi Yakitori. Ou un nom dans ce genre. Superbe manga, vraiment superbe. Dans le Japon des années 60, l’histoire d’un complot politique entre factions rivales de la police. Le héros est membre de la « division Panzer » (ach !) chargée du maintien de l’ordre dans des situations violentes. Pour cause de guerre des polices, on lui fiche dans les pattes une révolutionnaire criminelle, afin de compromettre toute son unité, jugée trop violente, et de s’en débarrasser. Le héros tombe amoureux, mais (on l’apprend ensuite), fait aussi partie d’une sorte de « police des polices ». Au lieu de tomber bêtement amoureux en bon occidental, il choisit son devoir, et fait un beau ménage, de la fille, des policiers véreux, des comploteurs, etc.
L’analogie avec le petit chaperon rouge court tout le long du film. C’est déjà hardi d’avoir fait du chaperon rouge une poseuse de bombes, du loup le gentil de l’histoire… mais en plus c’est le loup qui gagne, en privilégiant son côté animal sur ses tentations « humaines ». J’ai du mal à imaginer un film « live » racontant une telle histoire, et pourtant, elle mériterait d’être racontée.
Les dessins sont merveilleux, et les passages de spleen du héros, où on le croit vraiment amoureux, sont rendus à merveille. La musique ne dépare pas ; bref, un chef d’œuvre qui montre où peut aller le dessin animé s’il est bien conçu, et sous-tendu par une histoire intelligente.
L’analogie avec le petit chaperon rouge court tout le long du film. C’est déjà hardi d’avoir fait du chaperon rouge une poseuse de bombes, du loup le gentil de l’histoire… mais en plus c’est le loup qui gagne, en privilégiant son côté animal sur ses tentations « humaines ». J’ai du mal à imaginer un film « live » racontant une telle histoire, et pourtant, elle mériterait d’être racontée.
Les dessins sont merveilleux, et les passages de spleen du héros, où on le croit vraiment amoureux, sont rendus à merveille. La musique ne dépare pas ; bref, un chef d’œuvre qui montre où peut aller le dessin animé s’il est bien conçu, et sous-tendu par une histoire intelligente.
Tourisme : WE à Londres.
A 17 h à la gare du Nord par un froid glacial. Café, puis embarquement dans l’Eurostar. Un beau foutoir ; cela joue à l’avion, mais on garde ses valises avec soi et finalement c’est beaucoup de temps perdu pour monter juste dans un train – en seconde, horresco referens. J’aurais dû faire une crise d’angoisse.
Les salles d’embarquement n’ont pas de sièges pour tout le monde, il faut acheter les journaux et les consommations, bref, ce n’est pas l’avion du tout ! Ceci dit, c’est la première fois que je prends le tunnel sous la Manche.
Du côté anglais, on passe par Ashford, Tonbridge. Je remarque « Petts Wood » au passage, ce qui devrait éveiller déjà des souvenirs chez deux de mes lecteurs. « Bromley south, Bickley, Petts Wood, Orpington », c’était la fin de l’annonce qui précédait le départ des trains pour Beckenham. Mais comment s’appelait la gare entre Beckenham Junction et Bromley south ? Shortlands, je parie que vous l’avez oublié comme moi.
Bref, nous remontons une ligne connue jusqu’à Clapham ou un embranchement nouvellement construit nous emmène à Waterloo, qui a beaucoup changé depuis que j’y étais. Mon dernier séjour à Londres date en effet de 1993, si je ne m’abuse. Et à l’époque ma situation à Beckenham chez l’habitant me forçait à rentrer pour dîner et à ne pas ressortir.
Un car nous emmène à Bloomsbury où se trouve notre hotel, un Holiday Inn très bien mais au mobilier un peu fatigué.
De fait, plusieurs choses m’ont frappé. Londres est restée la même mais a bien changé aussi. Dans le sens d’une internationalisation, et d’une américanisation. Les restaurants à thème, les coffee houses et autres mangeoires semblables à l’Alcazar tiennent le haut du pavé là où à l’époque n’existaient que quelques take-away indiens et les MacDo. Il y a des Starbucks à tous les coins de rue là où Paris n’en connaît pas un seul, et trois ou quatre autres chaînes du même genre. Le reste est occupé par des pizzerias clean, des chinois à la mode (« Mr Wu », où l’on se sert au buffet) ou des japonais. Les resturants français se multiplient mais restent haut de gamme. Les végétariens sont aussi très présents.
En un mot comme en cent – et c’est une révolution culturelle de tout premier ordre – Londres est devenue en dix ans une ville passionnée de nourriture. Non que les pubs aient disparus (ils se sont fondus dans la masse), mais plein d’autres choses sont apparues, faisant de la ville un endroit où il n’est plus nécessaire d’avoir peur de manger. Il y a dix ans, j’allais au PizzaLand (à Richmond ou sur Oxford St.), ou manger les sandwiches de luxe de « Prêt à manger » à Holborn, qui était déjà un signe de ce qui allait venir à une époque ou Linas n’était même pas inventé. Aujourd’hui, il y a des « prêt à manger » partout, et PizzaLand est franchement dépassé au profit de japonais diététiques alternatifs que l’on n’imagine encore même pas à Paris. Je ne m’attendais pas à ce choc.
A l’hôtel, une notice accompagne le breakfast, m’indiquant DIX raisons pour lesquelles il est important d’en prendre un. Passionate about food, I say.
Et voilà ma première incursion dans le métro londonien depuis huit ans. Je ne peux pas m’empêcher de sourire, comme lorsque je redécouvre un vieil ami. L’ambiance, l’odeur n’ont pas changé.
Je fais une croix sur un bar à bières belges dont le guide me vante les serveurs habillés en moines, et je choisis d’errer vers Leicester Square, où je tombe sur Wagamama.
Wagamama est un bar à nouilles japonais. Le nom veut dire « manger positif », ou quelque chose de ce genre. Je pénètre dans une salle souterraine avec un mobilier de cantine (longues tables, bancs) revisité par Ikea. Serveuses sympathiques (« hi ! ») à piercing qui prennent les commandes sur des iPaq et les envoient par infra-rouge à la cuisine. Le menu prend soin du débutant, et informe que les side dishes ne sont pas des entrées ; que d’ailleurs un repas, ici, consiste en un plat, point. Que wagamama est conçu comme un restaurant « non-destinationel » qui, donc, n’accepte pas de prendre de réservation. Que wagamama est, bien entendu, totalement non-fumeur ; qu’un bon jus de fruit avant le repas nettoie le corps de ses toxines ; qu’il y a trois sortes de nouilles dont une qui baigne dans la soupe ; qu’il ne faut pas avoir peur de faire slurp avec les nouilles, bien au contraire : cela améliore leur goût, et d’ailleurs les japs font comme ça.
Je prends des yaki udon (ne me demandez pas ce que c’est) et des beignets de crevette en accompagnement. Comme boisson, du « gusto », encore un truc qui n’est pas arrivé ici. Du jus de pomme et de raison pétillant, avec du guarana. Ceux qui sont allé au Brésil savent que le guarana est une substance végétale amazonienne dont on fait le coca-cola du coin, et qui passe pour être excitante ET aphrodisiaque. J’avais prédit que le guarana allait devenir LA boisson du XXIème siècle ; le voici qui a mis un pied en Europe.
Wagamama a le bon goût de prendre les Amex. Retour à l’hôtel où je regarde une partie de billard à la télé. Un chapitre de Harry Potter et au dodo.
Samedi 15 décembre 2001
Petit déjeuner anglais – ô extase. Relève de la garde à Whitehall. Puis lèche-vitrines intense chez les libraires de Charing Cross Rd. Il y a toujours Foyles, où j’avais trouvé il y a longtemps le dernier exemplaire de How to be an alien de George Mikes. Est-ce que mes lecteurs se souviennent de Foyles ? C’est toujours aussi vieillot et caverne d’Ali-Baba. On y trouve des méthodes de swahili, une profusion d’ouvrages sur les guerres napoléoniennes – dont les Anglais semblent friands – et des dizaines d’autres ouvrages. Dont un opus passionnant sur le RER parisien et plein d’autres sur le métro londonien. Un par ligne.
En face, la nouvelle librairie ouverte depuis peu, Borders, propose d’autres livres tout aussi intéressants et un café. J’en ressors avec un bouquin sur Miles Davis, le dernier de Stephen Hawking 50 balles moins cher qu’en France, et un petit truc de poche « things a man should know about style » que je vais abondamment citer ces prochains temps. (« des chaussures à 1200 F durent aussi longtemps que des chaussures à 600 F ; des chaussures à 2500 F durent toute une vie. ») C’est édité par les journalistes d’ esquire, qui s’y connaissent assez en élégance. (« blue jeans : weekends. Black jeans : weekend nights. White jeans : with those elf boots you saved from the eighties.”)
Je regarde aussi assez longtemps un albums de la Far side gallery, souvent hilarant. Un des dessins montre un chien en train de se gratter, et deux petites voix de tiques qui proviennent de son pelage : « the Claw ! The Claw is back ! Where are the children?”
L’après midi, voyage en métro. Je prends la jubilee line, qui ne termine plus à Charing Cross maintenant, mais passe directement à Westminster (station monumentale un peu comme celles de la ligne E à Paris), puis Waterloo, rallie les docks à Canary Wharf puis fait une boucle vers Stratford.
Les docks ont bien changé aussi, mais sont toujours en construction. Ils sont juste un peu plus grands, et l’Ile aux Chiens est comme un petit Manhattan. Dire que j’ai connu (et photographié) cela alors qu’il n’y avait que des échafaudages ! Le petit train ne tombe plus en panne et s’est développé en deux lignes croisées. La ligne verticale franchit désormais la Tamise, et traverse Greenwich jusqu’à Lewisham. La ligne horizontale passe le long de l’aéroport de la City et va jusqu’à Beckton. Le paysage est désolé comme une couverture de disque new-wave, terrains vagues, usines crasseuses ; mais il y a fort à parier que d’ici dix ans, cela sera aussi industrieux que l’Ile aux Chiens actuellement.
J’ai été désolé d’apprendre, dans un autre registre, que la ligne Epping-Ongar, si pittoresque, est maintenant fermée depuis sept ans. Nous l’avons prise, je crois, en 93, et elle a fermé en 94. Des photos subsistent. En revanche, celle d’Amersham fonctionne toujours. J’ai même épaté l’autre jour le directeur de la filiale anglaise en lui montrant que je savais où était Amersham. Le nom était venu dans la conversation.
Les salles d’embarquement n’ont pas de sièges pour tout le monde, il faut acheter les journaux et les consommations, bref, ce n’est pas l’avion du tout ! Ceci dit, c’est la première fois que je prends le tunnel sous la Manche.
Du côté anglais, on passe par Ashford, Tonbridge. Je remarque « Petts Wood » au passage, ce qui devrait éveiller déjà des souvenirs chez deux de mes lecteurs. « Bromley south, Bickley, Petts Wood, Orpington », c’était la fin de l’annonce qui précédait le départ des trains pour Beckenham. Mais comment s’appelait la gare entre Beckenham Junction et Bromley south ? Shortlands, je parie que vous l’avez oublié comme moi.
Bref, nous remontons une ligne connue jusqu’à Clapham ou un embranchement nouvellement construit nous emmène à Waterloo, qui a beaucoup changé depuis que j’y étais. Mon dernier séjour à Londres date en effet de 1993, si je ne m’abuse. Et à l’époque ma situation à Beckenham chez l’habitant me forçait à rentrer pour dîner et à ne pas ressortir.
Un car nous emmène à Bloomsbury où se trouve notre hotel, un Holiday Inn très bien mais au mobilier un peu fatigué.
De fait, plusieurs choses m’ont frappé. Londres est restée la même mais a bien changé aussi. Dans le sens d’une internationalisation, et d’une américanisation. Les restaurants à thème, les coffee houses et autres mangeoires semblables à l’Alcazar tiennent le haut du pavé là où à l’époque n’existaient que quelques take-away indiens et les MacDo. Il y a des Starbucks à tous les coins de rue là où Paris n’en connaît pas un seul, et trois ou quatre autres chaînes du même genre. Le reste est occupé par des pizzerias clean, des chinois à la mode (« Mr Wu », où l’on se sert au buffet) ou des japonais. Les resturants français se multiplient mais restent haut de gamme. Les végétariens sont aussi très présents.
En un mot comme en cent – et c’est une révolution culturelle de tout premier ordre – Londres est devenue en dix ans une ville passionnée de nourriture. Non que les pubs aient disparus (ils se sont fondus dans la masse), mais plein d’autres choses sont apparues, faisant de la ville un endroit où il n’est plus nécessaire d’avoir peur de manger. Il y a dix ans, j’allais au PizzaLand (à Richmond ou sur Oxford St.), ou manger les sandwiches de luxe de « Prêt à manger » à Holborn, qui était déjà un signe de ce qui allait venir à une époque ou Linas n’était même pas inventé. Aujourd’hui, il y a des « prêt à manger » partout, et PizzaLand est franchement dépassé au profit de japonais diététiques alternatifs que l’on n’imagine encore même pas à Paris. Je ne m’attendais pas à ce choc.
A l’hôtel, une notice accompagne le breakfast, m’indiquant DIX raisons pour lesquelles il est important d’en prendre un. Passionate about food, I say.
Et voilà ma première incursion dans le métro londonien depuis huit ans. Je ne peux pas m’empêcher de sourire, comme lorsque je redécouvre un vieil ami. L’ambiance, l’odeur n’ont pas changé.
Je fais une croix sur un bar à bières belges dont le guide me vante les serveurs habillés en moines, et je choisis d’errer vers Leicester Square, où je tombe sur Wagamama.
Wagamama est un bar à nouilles japonais. Le nom veut dire « manger positif », ou quelque chose de ce genre. Je pénètre dans une salle souterraine avec un mobilier de cantine (longues tables, bancs) revisité par Ikea. Serveuses sympathiques (« hi ! ») à piercing qui prennent les commandes sur des iPaq et les envoient par infra-rouge à la cuisine. Le menu prend soin du débutant, et informe que les side dishes ne sont pas des entrées ; que d’ailleurs un repas, ici, consiste en un plat, point. Que wagamama est conçu comme un restaurant « non-destinationel » qui, donc, n’accepte pas de prendre de réservation. Que wagamama est, bien entendu, totalement non-fumeur ; qu’un bon jus de fruit avant le repas nettoie le corps de ses toxines ; qu’il y a trois sortes de nouilles dont une qui baigne dans la soupe ; qu’il ne faut pas avoir peur de faire slurp avec les nouilles, bien au contraire : cela améliore leur goût, et d’ailleurs les japs font comme ça.
Je prends des yaki udon (ne me demandez pas ce que c’est) et des beignets de crevette en accompagnement. Comme boisson, du « gusto », encore un truc qui n’est pas arrivé ici. Du jus de pomme et de raison pétillant, avec du guarana. Ceux qui sont allé au Brésil savent que le guarana est une substance végétale amazonienne dont on fait le coca-cola du coin, et qui passe pour être excitante ET aphrodisiaque. J’avais prédit que le guarana allait devenir LA boisson du XXIème siècle ; le voici qui a mis un pied en Europe.
Wagamama a le bon goût de prendre les Amex. Retour à l’hôtel où je regarde une partie de billard à la télé. Un chapitre de Harry Potter et au dodo.
Samedi 15 décembre 2001
Petit déjeuner anglais – ô extase. Relève de la garde à Whitehall. Puis lèche-vitrines intense chez les libraires de Charing Cross Rd. Il y a toujours Foyles, où j’avais trouvé il y a longtemps le dernier exemplaire de How to be an alien de George Mikes. Est-ce que mes lecteurs se souviennent de Foyles ? C’est toujours aussi vieillot et caverne d’Ali-Baba. On y trouve des méthodes de swahili, une profusion d’ouvrages sur les guerres napoléoniennes – dont les Anglais semblent friands – et des dizaines d’autres ouvrages. Dont un opus passionnant sur le RER parisien et plein d’autres sur le métro londonien. Un par ligne.
En face, la nouvelle librairie ouverte depuis peu, Borders, propose d’autres livres tout aussi intéressants et un café. J’en ressors avec un bouquin sur Miles Davis, le dernier de Stephen Hawking 50 balles moins cher qu’en France, et un petit truc de poche « things a man should know about style » que je vais abondamment citer ces prochains temps. (« des chaussures à 1200 F durent aussi longtemps que des chaussures à 600 F ; des chaussures à 2500 F durent toute une vie. ») C’est édité par les journalistes d’ esquire, qui s’y connaissent assez en élégance. (« blue jeans : weekends. Black jeans : weekend nights. White jeans : with those elf boots you saved from the eighties.”)
Je regarde aussi assez longtemps un albums de la Far side gallery, souvent hilarant. Un des dessins montre un chien en train de se gratter, et deux petites voix de tiques qui proviennent de son pelage : « the Claw ! The Claw is back ! Where are the children?”
L’après midi, voyage en métro. Je prends la jubilee line, qui ne termine plus à Charing Cross maintenant, mais passe directement à Westminster (station monumentale un peu comme celles de la ligne E à Paris), puis Waterloo, rallie les docks à Canary Wharf puis fait une boucle vers Stratford.
Les docks ont bien changé aussi, mais sont toujours en construction. Ils sont juste un peu plus grands, et l’Ile aux Chiens est comme un petit Manhattan. Dire que j’ai connu (et photographié) cela alors qu’il n’y avait que des échafaudages ! Le petit train ne tombe plus en panne et s’est développé en deux lignes croisées. La ligne verticale franchit désormais la Tamise, et traverse Greenwich jusqu’à Lewisham. La ligne horizontale passe le long de l’aéroport de la City et va jusqu’à Beckton. Le paysage est désolé comme une couverture de disque new-wave, terrains vagues, usines crasseuses ; mais il y a fort à parier que d’ici dix ans, cela sera aussi industrieux que l’Ile aux Chiens actuellement.
J’ai été désolé d’apprendre, dans un autre registre, que la ligne Epping-Ongar, si pittoresque, est maintenant fermée depuis sept ans. Nous l’avons prise, je crois, en 93, et elle a fermé en 94. Des photos subsistent. En revanche, celle d’Amersham fonctionne toujours. J’ai même épaté l’autre jour le directeur de la filiale anglaise en lui montrant que je savais où était Amersham. Le nom était venu dans la conversation.

Retour dans la city par Cannon street ; puis je rallie St Martin in the Fields pour entendre un concert de Noël aux chandelles, la spécialité londonienne de la saison. St Martin in the Fields est l’église huppée de Trafalgar Square où se déroule une des scènes de Quatre mariages et un enterrement. Je suis gratifié d’une excellente interprétation d’une ceremony of carols de Benjamain Britten. La seconde partie est faite de Noëls populaires, presque tous inconnus en France. Le public est prié de se lever et de chanter avec certains. O come ye all faithful n’est autre qu’un Adeste fideles traduit; et le dernier du programme reprenait la mélodie de Saints de France que l’on doit, paraît-il, au plus anglais des compositeurs germaniques, Felix Mendelssohn. Le chef bouge comme un beau diable, se tortille, semble être Elvis Presley par moments, et monte dans la chaire pour diriger le public dans le numéro final. Le public applaudit le chef sans retenue. Concert très agréable.
Dehors il gèle et je me rabats chez wagamama pour goûter autre chose. Je sirote un jus d’ « elderflowers » (translation, anyone ?), un jus de carotte (beuark ! je ne suis pas prêt pour le jus de carotte) et des ramen, en veillant à bien faire le slurping noise approprié. Que quiconcque a déjà mangé des nouilles dans de la soupe avec des baguettes me jette la première pierre.
Dimanche 16 décembre 2001
Mes pas matinaux me poussent vers Fortnum and Mason où je ne visite que le premier étage, the food hall. C’est un prétexte suffisant pour déménager à Londres, ce food hall. J’y repère un choix de vins intelligent (peu de Bordeaux !!!), avec notamment une bouteille de Château Grillet (c’est donc là qu’elles se cachaient), et un Chambertin Clos de Bèze 1997 à 950 balles. Fauchon et Hédiard peuvent aller se rhabiller.
Comme j’ai petit dejeuné il y a peu, je résiste à l’appel impérieux du « salmon and champagne bar » situé plus haut.
Le reste de la journée se passe à errer de ça de là. Nombre de boutiques sont ouvertes. Je finis sur Regent street qui est comme l’Avenue Montaigne de Londres. Je trouve là un hérisson en cristal chez Swarowski (pour maman), et un livre de photos de Yann Arthus-Bertrand pour papa. Après la nourriture, il semble que les Anglais s’attaquent aux vêtements et veulent sortir des éternels Barbour et Burberrys. Excellente idée ! Austin Reed semble être un bon choix pour les chemises ; et on sait ce que je pense de Church dont les chaussures durent une vie, comme on sait. La mode à venir ose les chemises à carreaux en diagonale, roses s’il le faut. Pink est une marque à suivre dans le côté pop de l’élégance.
(Note de 2003 : depuis, la rayure en diagonale a été adoptée en France par les zyva en recherche d’élégance, les vieux cons de quarante ans et les gommeux qui ont hypothéqué la maison pour acheter le Z3, on se contentera d’autre chose)
Off to Waterloo station. Foutoir indescriptible. Arrivée à Paris à onze heures et « voilà », comme disent les Anglais.
Dehors il gèle et je me rabats chez wagamama pour goûter autre chose. Je sirote un jus d’ « elderflowers » (translation, anyone ?), un jus de carotte (beuark ! je ne suis pas prêt pour le jus de carotte) et des ramen, en veillant à bien faire le slurping noise approprié. Que quiconcque a déjà mangé des nouilles dans de la soupe avec des baguettes me jette la première pierre.
Dimanche 16 décembre 2001
Mes pas matinaux me poussent vers Fortnum and Mason où je ne visite que le premier étage, the food hall. C’est un prétexte suffisant pour déménager à Londres, ce food hall. J’y repère un choix de vins intelligent (peu de Bordeaux !!!), avec notamment une bouteille de Château Grillet (c’est donc là qu’elles se cachaient), et un Chambertin Clos de Bèze 1997 à 950 balles. Fauchon et Hédiard peuvent aller se rhabiller.
Comme j’ai petit dejeuné il y a peu, je résiste à l’appel impérieux du « salmon and champagne bar » situé plus haut.
Le reste de la journée se passe à errer de ça de là. Nombre de boutiques sont ouvertes. Je finis sur Regent street qui est comme l’Avenue Montaigne de Londres. Je trouve là un hérisson en cristal chez Swarowski (pour maman), et un livre de photos de Yann Arthus-Bertrand pour papa. Après la nourriture, il semble que les Anglais s’attaquent aux vêtements et veulent sortir des éternels Barbour et Burberrys. Excellente idée ! Austin Reed semble être un bon choix pour les chemises ; et on sait ce que je pense de Church dont les chaussures durent une vie, comme on sait. La mode à venir ose les chemises à carreaux en diagonale, roses s’il le faut. Pink est une marque à suivre dans le côté pop de l’élégance.
(Note de 2003 : depuis, la rayure en diagonale a été adoptée en France par les zyva en recherche d’élégance, les vieux cons de quarante ans et les gommeux qui ont hypothéqué la maison pour acheter le Z3, on se contentera d’autre chose)
Off to Waterloo station. Foutoir indescriptible. Arrivée à Paris à onze heures et « voilà », comme disent les Anglais.
Livre : Legionnaire, de Simon Murray et quelques autres
Je lis Legionnaire de Simon Murray, sur lequel je suis tombé à Londres. L’auteur y raconte ses mémoires de jeunesse, c’est à dire comment, à dix neuf ans, vaguement romantique et assoiffé d’aventures, il a traversé la Manche pour s’engager dans la Légion Etrangère. Les chapitres à venir nous promettent des aspects historiques intéressants sur l’Algérie de 1960, puisque c’est là que se passe l’histoire. Pour le moment, ce sont des semaines de formation qui sont racontées, dans une langue simple et vivante. Je pense à *** (un scout, pensionnaire des lefévristes, qui voulait s’engager dans la légion dès seize ans et gardait l’insigne à la grenade dans son portefeuille) avec un sourire en coin.
Mes autres lectures du moment : le troisième tome d’ Harry Potter (en français) et the illustrated A Brief History of Time de Stephen Hawking, que j’avais déjà lu sans illustrations en 92, alors que le livre était moins célèbre que maintenant. J’ai trouvé l’ouvrage encore plus passionnant qu’à la première lecture, et remarquablement bien écrit. Hawking est quelqu’un qui sait structurer sa prose et vulgariser tout en donnant un tour captivant à ce qu’il écrit. Sans doute un des livres scientifiques les plus importants du siècle, à ranger aux côtés d’œuvres analogues d’Einstein et d’Henri Poincaré sur le même sujet.
Il est tout de même remarquable que les meilleurs vulgarisateurs vivants soient anglo-saxons. Hawking, mais aussi James Gleick (lu en 93) ou Ian Stewart (découvert par Aurélie) racontent des choses intéressantes que les autres ne racontent pas. The universe in a nutshell est d’ores et déjà sur mon étagère.
Maurice Dantec, Le théâtre des opérations. Le « journal métaphysique et polémique » d’un auteur de romans noirs. L’auteur en question n’est pas un modéré : anti-chrétien, anti-communiste, pro-darwiniste, et férocement à droite ; voilà qui soutient les six cents pages de ce manifeste. Y lire que la conception virginale de Jésus serait l’œuvre d’extra-terrestres n’y est pas le plus surprenant.
The Paris RER handbook trouvé chez Foyles, puisqu’aucune librairie de Paris ne semble avoir d’ouvrage sur le sujet. A mon grand regret, j’ai laissé Things a man should know about style chez moi.
Mes autres lectures du moment : le troisième tome d’ Harry Potter (en français) et the illustrated A Brief History of Time de Stephen Hawking, que j’avais déjà lu sans illustrations en 92, alors que le livre était moins célèbre que maintenant. J’ai trouvé l’ouvrage encore plus passionnant qu’à la première lecture, et remarquablement bien écrit. Hawking est quelqu’un qui sait structurer sa prose et vulgariser tout en donnant un tour captivant à ce qu’il écrit. Sans doute un des livres scientifiques les plus importants du siècle, à ranger aux côtés d’œuvres analogues d’Einstein et d’Henri Poincaré sur le même sujet.
Il est tout de même remarquable que les meilleurs vulgarisateurs vivants soient anglo-saxons. Hawking, mais aussi James Gleick (lu en 93) ou Ian Stewart (découvert par Aurélie) racontent des choses intéressantes que les autres ne racontent pas. The universe in a nutshell est d’ores et déjà sur mon étagère.
Maurice Dantec, Le théâtre des opérations. Le « journal métaphysique et polémique » d’un auteur de romans noirs. L’auteur en question n’est pas un modéré : anti-chrétien, anti-communiste, pro-darwiniste, et férocement à droite ; voilà qui soutient les six cents pages de ce manifeste. Y lire que la conception virginale de Jésus serait l’œuvre d’extra-terrestres n’y est pas le plus surprenant.
The Paris RER handbook trouvé chez Foyles, puisqu’aucune librairie de Paris ne semble avoir d’ouvrage sur le sujet. A mon grand regret, j’ai laissé Things a man should know about style chez moi.
Film : Le Seigneur des Anneaux – la communauté de l’anneau, de Peter Jackson
De retour à Paris. La fin de l’année s’est déroulée de façon totalement anecdotique. Je suis allé néanmoins voir le Seigneur des Anneaux qui est une réussite éclatante sur bien des points. Visuellement et sonorement, c’est impressionnant ; et dans la manière de raconter l’histoire, de filmer, si cela semble manquer de génie, de personnalité, cela fait néanmoins preuve d’un art consommé (que l’on ne devinait pas vraiment en regardant cette bouse que sont les feebles, et que l’on ne devinait que partiellement en regardant Forgotten Silver). Le film dure trois heures qui m’ont semblé une heure et demie (je n’ai pas lu le livre) et évite les écueils du manichéisme outré et de la fantasmagorie (on entend toutefois un nom inventé par minute).
Bref, en sortant, je me suis demandé si le film allait oblitérer la marque de Star wars sur le cinéma. Je me suis dit que non, mais l’univers dépeint a le pouvoir de rester dans l’esprit du spectateur après coup, très longtemps, comme si ce que l’on avait vu était vrai… et cela, c’est plutôt rare ; je me demande maintenant si le Seigneur des anneaux ne va pas fixer des nouveaux niveaux pour le cinéma à venir. Certes la réalisation donne parfois l’impression d’être hollywoodienne, académique mais filmée avec un très grand talent ; il y a tout de même des différences ; l’insistance sur les gros plans de visage – le fait que bien des passages sont réellement effrayants (Dark Vador a l’air d’un gamin à côté des manifestations du mal représentées ici). La musique n’est pas au niveau du reste, hélas.
Exemple d’académisme : Gandalf qui tombe du haut du pont dans la mine. Frodon hurle « noooooon ! » On se croirait dans Scary movie ! Plusieurs spectateurs s’attendaient à ce cri et le faisaient en sourdine une seconde avant. Du coup le passage a pris un tour hilarant qui n’était certes pas dans les intentions du réalisateur.
Bref, un très bon film que tout le monde aura vu d’ici peu et dont tout le monde parlera. Peter Jackson est-il un maître ? Cela ne fait plus de doute. Un génie ? Je me le demande encore.
Bref, en sortant, je me suis demandé si le film allait oblitérer la marque de Star wars sur le cinéma. Je me suis dit que non, mais l’univers dépeint a le pouvoir de rester dans l’esprit du spectateur après coup, très longtemps, comme si ce que l’on avait vu était vrai… et cela, c’est plutôt rare ; je me demande maintenant si le Seigneur des anneaux ne va pas fixer des nouveaux niveaux pour le cinéma à venir. Certes la réalisation donne parfois l’impression d’être hollywoodienne, académique mais filmée avec un très grand talent ; il y a tout de même des différences ; l’insistance sur les gros plans de visage – le fait que bien des passages sont réellement effrayants (Dark Vador a l’air d’un gamin à côté des manifestations du mal représentées ici). La musique n’est pas au niveau du reste, hélas.
Exemple d’académisme : Gandalf qui tombe du haut du pont dans la mine. Frodon hurle « noooooon ! » On se croirait dans Scary movie ! Plusieurs spectateurs s’attendaient à ce cri et le faisaient en sourdine une seconde avant. Du coup le passage a pris un tour hilarant qui n’était certes pas dans les intentions du réalisateur.
Bref, un très bon film que tout le monde aura vu d’ici peu et dont tout le monde parlera. Peter Jackson est-il un maître ? Cela ne fait plus de doute. Un génie ? Je me le demande encore.






 Jean-Louis Foncine, romancier pour la jeunesse
Jean-Louis Foncine, romancier pour la jeunesse