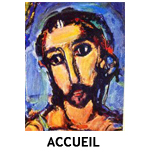« Il n'en reste pas moins vrai que ce sont bien des officiers français, venus pour beaucoup des rangs de la résistance au nazisme, qui, au nom d'une idéologie - l'anticommunisme et la défense des valeurs de l'Occident chrétien -, ont mis au point lors des guerres coloniales en Indochine et en Algérie des « méthodes de guerre » qui ont légitimé les pires sauvageries contre les populations civiles. Et ces méthodes, grâce à leur efficacité, sont devenues des modèles, voire des fins en soi, pour des chefs politiques, dictateurs et despotes (dans le tiers monde et en Russie) ou démocrates (aux États-Unis). Il s'agit là d'une vérité historique que la France officielle ne peut continuer à occulter, en invoquant encore et toujours la « raison d'État ».
La citation ci-dessus résume bien le contenu de l'intéressant livre de Marie-Monique Robin intitulé Escadrons de la mort, l'école française (la Découverte, éditeur). Ce n'est pas un livre d'histoire à proprement parler mais de journalisme d'investigation assez poussé ; son auteur ne mesure pas les notes et les références, mais tombe parfois dans l'amalgame ou le raccourci. Journalisme aussi car l'enquête de l'auteur semble s'être développée au hasard des rencontres et des avancées plutôt que de manière systématique, sans que cela enlève la moindre qualité au travail, ou rende sa lecture moins captivante.
L'auteur a voulu faire l'histoire de la « guerre révolutionnaire » à laquelle l'armée française s'est trouvée confrontée en Indochine, et de la manière dont cette dernière y a répondu, en forgeant de nouveaux concepts (l' « action psychologique »), de nouveaux modes d'action (le quadrillage des zones, la torture, l'assassinat politique, l'usage de l'hélicoptère comme arme de combat), une nouvelle vision de la guerre (place prépondérante du renseignement) et des circonstances dans lesquelles elle se déroule (pays où tout individu est gagné à la cause révolutionnaire ; où tout individu est potentiellement un révolutionnaire prêt à prendre les armes) et de son arrière-plan idéologique (la guerre prépare le chemin à une subversion communiste généralisée).
L'auteur montre ensuite comment ces concepts, parvenus à maturité, ont été appliqués tels quels en Algérie où ils ont conduit finalement au désastre politique que l'on sait en 1962. La « guerre révolutionnaire » est alors théorisée par une poignée d'officiers et enseignée dans les écoles militaires en France, puis exportée aux USA (où elle rencontre un accueil tiède, notamment en raison de son usage banalisé de la torture) et en Amérique du Sud.
Dans les années 70, elle est utilisée par la quasi-totalité des régimes latino-américains, contre leur propre peuple, soupçonné de fomenter une révolution marxiste. L'auteur détaille en particulier l'usage que les régimes chilien et argentin en ont fait, ce dernier se distinguant par sa férocité aveugle (je recommande de lire, avant le repas, les paragraphes sur les « vols de la mort » argentins pour se mettre en appétit). Puis dans les années qui suivent c'est en Algérie, au Rwanda, en Tchétchénie et ailleurs que l'on retrouve la doctrine française.
L'auteur consacre des pages à quelques excursus des plus intéressants, notamment au sujet de la guerre d'Algérie. On y voit comment le modèle français ne s'y est que partiellement adapté (le rôle de la subversion marxiste, notamment, n'était pas le même qu'en Indochine) ; on voit aussi comment les éléments les plus extrêmes de l'Algérie Française forment l'OAS et radicalisent les méthodes appliquées par les militaires jusqu'à en faire du terrorisme véritable. Les séides de l'OAS quitteront ensuite la France pour échapper à la justice et iront monter des réseaux d'extrême droite armée, notamment en Argentine, qui semble s'être montré particulièrement complaisante envers ces personnes.
Le travail de Mme Robin est illustré par de nombreux entretiens, notamment avec d'anciens tortionnaires, des militants de l'Algérie française, des terroristes de l'OAS pas repentis, des personnages louches qui ont basculé dans les dérives mafieuses, des militaires devenues « stars » à l'école de guerre à Paris, puis mercenaires en Afrique, et même un ou deux généraux de la junte argentine, toujours en liberté. Sa méthode est surprenament facile : elle se fait en général passer pour une historienne « amie » (entendez d'extrême droite), donne aux uns des nouvelles des autres. Il n'en faut en général pas plus pour que les langues se délient, et atteignent parfois un cynisme déconcertant.
On retrouve au cours du livre des personnages connus. En premier lieu le tueur le plus médiatique de France, je veux parler du général Aussaresses (à l'époque capitaine), toujours volontiers disert sur ce qu'il a fait. Dans « services secrets », nous le lisions en train de soulever un coin du voile sur le « renseignement » dans la bataille d'Alger. Nous le retrouvons ici en train de prêcher l'évangile du renseignement et de la guerre contre-subversive aux USA, à Fort Bragg, puis au Brésil, dans les années 60. Non pas en tant que baroudeur retraité qui interviendrait de son propre chef, mais sur ordre de sa hiérarchie, en coordination avec des missions militaires françaises implantées sur place ; c'est-à-dire de manière tout à fait officielle.
On a beaucoup critiqué le général Aussaresses. Nous l'avons dit, c'est un tueur qui ne semble pas avoir manifesté de scrupules ou d'hésitations dans l'exécution de son travail ; ni de condamnation ou de distanciation par rapport aux méthodes qu'il utilisait. (Le livre cite un email d'Aussaresses à un homologue américain : ils sont sur la même longueur d'onde, mais ce qui distingue les deux, c'est que l'américain n'accepte pas la torture, alors que le système d'Aussaresses en fait sa pierre d'angle). Il a toutefois eu le mérite de parler, quarante ans après les faits, et d'affirmer que la torture était un élément central du dispositif militaire français en Algérie, et qu'elle était voulue (au moins tacitement) par le pouvoir de l'époque. Au lieu de saluer l'avancée que cela procurait à l'histoire française contemporaine, on a accablé l'auteur de « services secrets », on lui a reproché de se livrer à une apologie de crime de guerre. Certes le personnage n'est pas des plus sympathiques ; il semble avoir mis ses scrupules une bonne fois pour toutes dans sa poche, et raconte quarante ans plus tard ses hautes oeuvres avec froideur et détachement (mais attend-on d'un bourreau qu'il s'emballe à l'idée de son métier, qu'il romance, qu'il enjolive, qu'il s'y complaise ?)
Ici, dans ce livre, des Aussaresses, nous en avons une poignée. Ils sont en général moins causants que l'original mais tous confirment, en choeur avec l'auteur, que la politique de quadrillage, de rafles, de torture et d'élimination secrètes n'était pas la réponse improvisée à une situation exceptionnelle, mais un plan mûrement réfléchi, théorisé puis exécuté. Qu'il n'y avait pas de hasard ou de dérapage dedans. Que cette approche de la guerre a été une invention française, puis qu'elle a été propagée avec l'appui du gouvernement français dans des endroits où elle a systématiquement été la fondation de régimes sanglants faisant la guerre à leur propre peuple, en temps de paix. On ne peut pas dire que tout cela est de la resucée.
Pourtant, il ne semble pas que le livre de Mme Robin ait ému outre mesure les politiques actuels ; quelques semaines après sa sortie, il n'a pas déclenché le scandale qu'on aurait pu attendre qu'il déclenche. La culture française du silence est omniprésente ; il suffit de se souvenir les réactions qui ont accueilli quelques mauvaises nouvelles, révélées comme à l'arrachée. La révélation de l'impréparation face à une possible crue centennale de la Seine, suivi de la révocation de son auteur. Le mot de Jospin sur les mutins de 1917 et la réprobation qui s'ensuivit. Les progrès du discours sur la guerre d'Algérie et sur les harkis, et les remous qu'il suscite encore. Alors que dans d'autres pays, la photo d'un prisonnier tenu en laisse suscite une commotion générale et des comparutions en cour matiale suivie d'années de prison ferme, l'implication française dans un certain nombre d'événements peu glorieux de la seconde moitié du XXème siècle semble laisser tout le monde de marbre. On ne dit rien, c'est comme si cela n'existait pas ; est-ce ainsi que l'on facilite le travail des historiens ? Est-ce ainsi que l'on soulage sa conscience ?
La citation ci-dessus résume bien le contenu de l'intéressant livre de Marie-Monique Robin intitulé Escadrons de la mort, l'école française (la Découverte, éditeur). Ce n'est pas un livre d'histoire à proprement parler mais de journalisme d'investigation assez poussé ; son auteur ne mesure pas les notes et les références, mais tombe parfois dans l'amalgame ou le raccourci. Journalisme aussi car l'enquête de l'auteur semble s'être développée au hasard des rencontres et des avancées plutôt que de manière systématique, sans que cela enlève la moindre qualité au travail, ou rende sa lecture moins captivante.
L'auteur a voulu faire l'histoire de la « guerre révolutionnaire » à laquelle l'armée française s'est trouvée confrontée en Indochine, et de la manière dont cette dernière y a répondu, en forgeant de nouveaux concepts (l' « action psychologique »), de nouveaux modes d'action (le quadrillage des zones, la torture, l'assassinat politique, l'usage de l'hélicoptère comme arme de combat), une nouvelle vision de la guerre (place prépondérante du renseignement) et des circonstances dans lesquelles elle se déroule (pays où tout individu est gagné à la cause révolutionnaire ; où tout individu est potentiellement un révolutionnaire prêt à prendre les armes) et de son arrière-plan idéologique (la guerre prépare le chemin à une subversion communiste généralisée).
L'auteur montre ensuite comment ces concepts, parvenus à maturité, ont été appliqués tels quels en Algérie où ils ont conduit finalement au désastre politique que l'on sait en 1962. La « guerre révolutionnaire » est alors théorisée par une poignée d'officiers et enseignée dans les écoles militaires en France, puis exportée aux USA (où elle rencontre un accueil tiède, notamment en raison de son usage banalisé de la torture) et en Amérique du Sud.
Dans les années 70, elle est utilisée par la quasi-totalité des régimes latino-américains, contre leur propre peuple, soupçonné de fomenter une révolution marxiste. L'auteur détaille en particulier l'usage que les régimes chilien et argentin en ont fait, ce dernier se distinguant par sa férocité aveugle (je recommande de lire, avant le repas, les paragraphes sur les « vols de la mort » argentins pour se mettre en appétit). Puis dans les années qui suivent c'est en Algérie, au Rwanda, en Tchétchénie et ailleurs que l'on retrouve la doctrine française.
L'auteur consacre des pages à quelques excursus des plus intéressants, notamment au sujet de la guerre d'Algérie. On y voit comment le modèle français ne s'y est que partiellement adapté (le rôle de la subversion marxiste, notamment, n'était pas le même qu'en Indochine) ; on voit aussi comment les éléments les plus extrêmes de l'Algérie Française forment l'OAS et radicalisent les méthodes appliquées par les militaires jusqu'à en faire du terrorisme véritable. Les séides de l'OAS quitteront ensuite la France pour échapper à la justice et iront monter des réseaux d'extrême droite armée, notamment en Argentine, qui semble s'être montré particulièrement complaisante envers ces personnes.
Le travail de Mme Robin est illustré par de nombreux entretiens, notamment avec d'anciens tortionnaires, des militants de l'Algérie française, des terroristes de l'OAS pas repentis, des personnages louches qui ont basculé dans les dérives mafieuses, des militaires devenues « stars » à l'école de guerre à Paris, puis mercenaires en Afrique, et même un ou deux généraux de la junte argentine, toujours en liberté. Sa méthode est surprenament facile : elle se fait en général passer pour une historienne « amie » (entendez d'extrême droite), donne aux uns des nouvelles des autres. Il n'en faut en général pas plus pour que les langues se délient, et atteignent parfois un cynisme déconcertant.
On retrouve au cours du livre des personnages connus. En premier lieu le tueur le plus médiatique de France, je veux parler du général Aussaresses (à l'époque capitaine), toujours volontiers disert sur ce qu'il a fait. Dans « services secrets », nous le lisions en train de soulever un coin du voile sur le « renseignement » dans la bataille d'Alger. Nous le retrouvons ici en train de prêcher l'évangile du renseignement et de la guerre contre-subversive aux USA, à Fort Bragg, puis au Brésil, dans les années 60. Non pas en tant que baroudeur retraité qui interviendrait de son propre chef, mais sur ordre de sa hiérarchie, en coordination avec des missions militaires françaises implantées sur place ; c'est-à-dire de manière tout à fait officielle.
On a beaucoup critiqué le général Aussaresses. Nous l'avons dit, c'est un tueur qui ne semble pas avoir manifesté de scrupules ou d'hésitations dans l'exécution de son travail ; ni de condamnation ou de distanciation par rapport aux méthodes qu'il utilisait. (Le livre cite un email d'Aussaresses à un homologue américain : ils sont sur la même longueur d'onde, mais ce qui distingue les deux, c'est que l'américain n'accepte pas la torture, alors que le système d'Aussaresses en fait sa pierre d'angle). Il a toutefois eu le mérite de parler, quarante ans après les faits, et d'affirmer que la torture était un élément central du dispositif militaire français en Algérie, et qu'elle était voulue (au moins tacitement) par le pouvoir de l'époque. Au lieu de saluer l'avancée que cela procurait à l'histoire française contemporaine, on a accablé l'auteur de « services secrets », on lui a reproché de se livrer à une apologie de crime de guerre. Certes le personnage n'est pas des plus sympathiques ; il semble avoir mis ses scrupules une bonne fois pour toutes dans sa poche, et raconte quarante ans plus tard ses hautes oeuvres avec froideur et détachement (mais attend-on d'un bourreau qu'il s'emballe à l'idée de son métier, qu'il romance, qu'il enjolive, qu'il s'y complaise ?)
Ici, dans ce livre, des Aussaresses, nous en avons une poignée. Ils sont en général moins causants que l'original mais tous confirment, en choeur avec l'auteur, que la politique de quadrillage, de rafles, de torture et d'élimination secrètes n'était pas la réponse improvisée à une situation exceptionnelle, mais un plan mûrement réfléchi, théorisé puis exécuté. Qu'il n'y avait pas de hasard ou de dérapage dedans. Que cette approche de la guerre a été une invention française, puis qu'elle a été propagée avec l'appui du gouvernement français dans des endroits où elle a systématiquement été la fondation de régimes sanglants faisant la guerre à leur propre peuple, en temps de paix. On ne peut pas dire que tout cela est de la resucée.
Pourtant, il ne semble pas que le livre de Mme Robin ait ému outre mesure les politiques actuels ; quelques semaines après sa sortie, il n'a pas déclenché le scandale qu'on aurait pu attendre qu'il déclenche. La culture française du silence est omniprésente ; il suffit de se souvenir les réactions qui ont accueilli quelques mauvaises nouvelles, révélées comme à l'arrachée. La révélation de l'impréparation face à une possible crue centennale de la Seine, suivi de la révocation de son auteur. Le mot de Jospin sur les mutins de 1917 et la réprobation qui s'ensuivit. Les progrès du discours sur la guerre d'Algérie et sur les harkis, et les remous qu'il suscite encore. Alors que dans d'autres pays, la photo d'un prisonnier tenu en laisse suscite une commotion générale et des comparutions en cour matiale suivie d'années de prison ferme, l'implication française dans un certain nombre d'événements peu glorieux de la seconde moitié du XXème siècle semble laisser tout le monde de marbre. On ne dit rien, c'est comme si cela n'existait pas ; est-ce ainsi que l'on facilite le travail des historiens ? Est-ce ainsi que l'on soulage sa conscience ?
La théologie de la torture selon la Cité catholique
Nous avons dit que l'auteur suivait quelques pistes plutôt qu'elle ne menait une enquête systématique. L'une de ses pistes nous intéresse à plus d'un titre : c'est celle de la Cité Catholique (désormais appelée Ictus), l'organisme bien connu des lecteurs de ce site, dédié à l'infiltration des élites du pays par la « doctrine sociale de l'Eglise », ou plutôt par une lecture d'icelle qui ne doit pas tant à Rerum Novarum qu'aux idées maurrassiennes et réactionnaires de Jean Ousset. L'auteur semble voir, entre la guerre contre-révolutionnaire théorisée par les militaires français et la doctrine de la Cité Catholique, un lien indissociable ; je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il soit si fort que cela ; mais il est indéniable. Il est également puisé à des sources autorisées, notamment Raphaëlle de Neuville, nièce de Jacques Trémollet de Villers, qui fut le président d'ICTUS, et auteur d'un travail universitaire sur Jean Ousset
Nous lisons donc, sans grande surprise, qu'il y a des affinités entre l'armée et la Cité Catholique. Affinités catholiques et réactionnaires, cela va sans dire et n'étonne personne. L'armée n'est pas à gauche, et nombre d'officiers à la mode en 1955 baignent dans des milieux classés à l'extrême droite, composés de petits mouvements autonomes où chacun tend à faire son marché chez les uns ou les autres. Nous lisons ensuite avec plus d'intérêt les noms de militants de l'OAS, de théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire, rapprochés de ceux de la Cité Catholique. Puis nous retrouvons ces mêmes noms dans une officine catho-tradi typique, les éditions de Chiré ; là, l'Algérie Française se fera présenter aux nostalgiques de la Collaboration. Les colonels Argoud et Château-Jobert, Claude Mouton, Robert Martel, tous ces noms se retrouvent sur le rôle de Chiré, parmi les tenants de l'Algérie Française, puis de l'OAS. La différence est ténue entre ce dernier et le milieu catho-tradi. Je découvre par là même qu'une frange considérable du paysage tradi est issue directement de l'Algérie Française (donc pas seulement de Vichy), donc de préoccupations qui n'ont rien à voir avec la religion. Que, tout en défendant une religion d'amour, elle ne s'est pas émue outre mesure des attentats anti-FLN, ni de la torture
Pire, on lit sous une plume de la Cité Catholique une justification voilée de la torture, voilée commodément par l'autorité morale et intellectuelle de St Thomas, qui, mort depuis longtemps, ne peut se récuser. Le terroriste, dit-on, ferait la guerre sans s'exposer aux risques qui sont le lot de tout soldat : être blessé, ou tué. La torture est une manière d'infliger ces souffrances, et de refaire peser sur le terroriste ce auquel il veut lâchement échapper. En quelque sorte, elle rétablit la balance. La Cité Catholique ne se pose pas plus de questions que cela ! Voilà, nous n'en doutons pas, quelque chose qu'on ne raconte pas tous les jours aux lecteurs de Permanences. Selon la Cité, la torture serait légitime, vas-y mon gars, tu peux y aller, on couvre ton salut éternel et en plus tu sauves ton pays et tu poses une action conforme à la vertu de justice. Signé : des docteurs de l'Eglise qui te veulent du bien.
Il y a plus amusant : l'un des « mistigris » que poursuit l'auteur n'est autre que le Père Georges Grasset, qui nous a prêché il y a longtemps une retraite de St Ignace, en compagnie d'un prêtre pétulant du diocèse de Lyon, célèbre à l'époque pour s'être enchaîné plusieurs fois dans des unités de gynécologie / obstétrique de quelques hôpitaux de la région, en signe de protestation contre l'avortement (et en toute illégalité, ce qui contribua à consommer l'argent de quelques pieux fidèles en frais de justice répétés).
Mme Robin n'arrive pas à mettre la main sur le Père Grasset ; elle récolte à la place les rumeurs sur l'intéressé. Ce serait le confesseur du général Videla, ou de quelques autres toujours en liberté à Buenos Aires après la loi d'amnistie. Ce serait un « homme de l'ombre », selon un permanent du « Centre » (le nouveau nom de la Cité Catholique, qui en change tous les dix ans). C'est très plausible ; l'intéressé lui-même m'avait confirmé qu'il passait la moitié de son année en Argentine. Je m'imaginais un peu naïvement qu'il vivait dans une petite mansarde, avec vue sur cour, dans un immeuble borgne avec du linge séchant aux fenêtres, se livrant à je ne sais quelles besognes humanitaires. Il semblerait que la scène se passe plutôt sous les ors du Circulo Militar de Retiro, en compagnie de bourreaux non repentis.
Là où Marie-Monique Robin quitte l'objectivité du journaliste pour endosser la casaque du militant, c'est lorsqu'elle s'acharne sur le père Grasset au point de livrer sur internet son adresse en Argentine (à quelques blocs de mon hôtel, cet été). C'est un peu dommage, d'autant qu'on ne voit pas à quoi cela pourrait servir, fors à nourrir la vindicte.
La retraite de votre serviteur avec le Père Grasset n'était pas triste, en effet ; il avait en effet un talent pour flatter son auditoire de jeunes tradis couillus (duas habent, et bene pendentes), pour les caresser dans le sens du poil, leur bourrer le crâne et niquer (pardon... « combattre ») l'ennemi principal selon lui : le sexe. Et tout le monde connaît la libido dévorante du jeune tradi couillu, qui se retient jusqu'au mariage - enfin, c'est ce qu'ils disent.
Je me souviens encore d'anecdotes piquantes (au sens propre), telle la planche à clous qu'il nous conseilla de nous faire pour vaincre les tentations nocturnes. C'était une réédition métallique des ronces de St Benoît : des punaises fichées dans un morceau de carton. En cas de besoin, il fallait marcher dessus, pieds nus. Il expliquait, dans son inimitable style qu'alors, « le sang partait des endroits où il ne devait pas se trouver ».
Je me souviens aussi du jour où il raconta comment il avait surpris dans les cabinets un garçon en train de se masturber. « Il ne faisait pas le fier, croyez-moi ». C'était selon lui la preuve que la masturbation était mauvaise : le garçon savait, intimement, de manière innée, que c'était mal. On peut aussi penser que le pauvre gosse, croyant la porte des cabinets fermée, a été surpris de la voir s'ouvrir, et pire, de la voir s'ouvrir sur le P. Grasset, raide comme la justice. Ce n'est peut être pas ce que l'on voudrait contempler lorsqu'on se branle. Ah ! Si seulement il avait eu la planche à clous miraculeuse, ou un sécateur à portée de main. Il vaut mieux se faire eunuque pour le royaume de Dieu, telle était la spiritualité du bon père...
Je parlais de bourrage de crâne, croyez que je n'exagère pas. Lors des consultations prévues dans les Exercices de St Ignace, le père Grasset tenta de guider mes aspirations politiques vers le Front National, en recommandant la frange catholique et en me décommandant la frange païenne (Martinez : recommandé ; Mégret : déconseillé). Lors d'un examen de mes goûts musicaux, le bon père me déconseilla formellement Mahler, trop lourd, trop boche, et me recommanda fortement d'écouter du Rameau à la place ; cela pourrait faire du bien à mon salut. Comme on le voit, les Exercices embrassent l'homme tout entier. Après cela, on comprend que j'aie préféré faire ma confession générale à l'autre prédicateur.
La dernière fois que j'ai vu le P. Grasset, ce devait être en 96 ou 97, il logeait chez les bénédictines de Rosans ; peut-être faisait-il fonction d'aumônier. Quelques mois plus tard, il était reparti ailleurs. L'enquête de Mme Robin me laisse un peu sur ma faim ; ce qu'elle dit du bonhomme colle avec ce que j'en sais, mais finalement, rien de son implication et de ses connivences n'est réglé. Je sais que c'est l'homme de la planche à clous ; je sais que c'est vraisemblablement l'homme de quelques complaisances gênantes ; je ne sais pas si c'est l'homme de quelque chose de plus grave.
Voici comment Mme Robin parle du père Grasset dans le journal argentin Pagina 12 ; la traduction a été mise sur le net sur le site du RISAL (Réseau International Solidarités d'Amérique Latine).
« Le personnage clé de cette organisation est le père Georges Grasset, qui a été le confesseur personnel de Videla et qui vit encore en Argentine. Guide spirituel de l'OAS qui, avec ses commandos Delta (escadrons de la mort) a essayé d'empêcher par les armes l'indépendance de l'Algérie. Dans l'Armée argentine, il existait un courant ultra-catholique intégriste, qui explique pourquoi l'influence des Français a été si importante. Lorsqu'il vient à Buenos Aires - Grasset vit à la Rue...(nom de la rue supprimé, pour ne pas faire ce que nous reprochons à l'auteur, NdNelly) - il entretient des liens avec la congrégation de Monseigneur Lefebvre, un évêque intégriste français qui a depuis été excommunié par le Vatican [Il est décédé en 1991 - né en 1905 ; la Congrégation a toujours son centre à Ecône, en Valais-Suisse, sous le nom de Fraternité sacerdotale Saint Pie X, ndlr]. Cette congrégation possède quatre monastères en Argentine, la principale à La Reja. Lorsque je suis allée à La Reja, j'ai parlé avec un curé français qui m'a dit : « Pour sauver l'âme d'un curé communiste, il faut le tuer »
L'un des enseignements du livre, c'est de mettre à jour une espèce d'internationale informelle d'extrême droite qui, sous la pression d'une menace communiste, a appliqué des méthodes formellement condamnées par le catholicisme qui était d'un des piliers revendiqués de la civilisation qu'elle entendait défendre. En fin de compte, cette internationale, née des besoins d'adaptation à un nouveau style de conflit, est devenue une machine d'autant plus sanguinaire que ceux qui la servaient étaient convaincus de sa nécessité.
Un second enseignement, c'est que cette machine de torture est devenue peu à peu son propre but, au point d'être utilisée par des gouvernements contre leur propre peuple ; ce qui était une technique de guerre est devenue une technique d'oppression.
Le troisième enseignement, c'est que les développeurs et les propagateurs enthousiastes de cette technique étaient français, et fiers de leur enfant monstrueux.
Le quatrième enseignement, c'est que la machine à torturer anti-communiste, ses auteurs et ses servants présentent des liens organiques avec le milieu catho-tradi ; qu'ils ont été bénis par ses prêtres, ses gourous et qu'ils ont cru agir en conformité avec ses enseignements. Ces liens restent encore à creuser. Le fait que l'on rencontre indistinctement la Cité Catholique, Chiré, l'OAS et les théoriciens de l'école de guerre dans les années 50 et 60 ne doit pas tromper : ces liens existent bel et bien. On trouvera certainement, si l'on cherche, quelques mythes ou scènes fondateurs du traditionalisme moderne dans l'histoire des « escadrons de la mort ».
Un autre enseignement, encore, c'est que la torture ne marche pas. Elle est immédiatement efficace pour obtenir un renseignement ; sur le long terme, elle est connue et décuple l'énergie de résistance des populations opprimées. L'Algérie est devenue indépendante, l'Amérique du Sud a rejeté toutes ses dictatures, la Russie ne se sort pas du bourbier tchétchène par plus que l'Algérie de ses troubles internes.
On a beaucoup glosé, et on glose encore, sur la pureté du marxisme et l'application déviante qui en aurait été faire par Lénine puis Staline : les politiques auraient détruit une belle idéologie qui n'était en rien grosse des goulags et de dizaines de millions de morts. Le rapprochement entre le catholicisme traditionaliste et des entreprises de mort telles que l'opération Condor, à l'échelle d'un continent, devrait poser la question de l'inspiration des dictateurs de droite depuis cinquante ans. L'OAS, Condor, la torture en Algérie : sont-ce là des produits regrettables et évitables d'une politique de camp retranché qui ne voulait que le bien et la liberté des populations ? Ou est-ce la conséquence nécessaire d'une idéologie religieuse mutante qui ne supporte rien d'autre qu'elle et détruit tout ce qui veut lui barrer la route ?
Nous lisons donc, sans grande surprise, qu'il y a des affinités entre l'armée et la Cité Catholique. Affinités catholiques et réactionnaires, cela va sans dire et n'étonne personne. L'armée n'est pas à gauche, et nombre d'officiers à la mode en 1955 baignent dans des milieux classés à l'extrême droite, composés de petits mouvements autonomes où chacun tend à faire son marché chez les uns ou les autres. Nous lisons ensuite avec plus d'intérêt les noms de militants de l'OAS, de théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire, rapprochés de ceux de la Cité Catholique. Puis nous retrouvons ces mêmes noms dans une officine catho-tradi typique, les éditions de Chiré ; là, l'Algérie Française se fera présenter aux nostalgiques de la Collaboration. Les colonels Argoud et Château-Jobert, Claude Mouton, Robert Martel, tous ces noms se retrouvent sur le rôle de Chiré, parmi les tenants de l'Algérie Française, puis de l'OAS. La différence est ténue entre ce dernier et le milieu catho-tradi. Je découvre par là même qu'une frange considérable du paysage tradi est issue directement de l'Algérie Française (donc pas seulement de Vichy), donc de préoccupations qui n'ont rien à voir avec la religion. Que, tout en défendant une religion d'amour, elle ne s'est pas émue outre mesure des attentats anti-FLN, ni de la torture
Pire, on lit sous une plume de la Cité Catholique une justification voilée de la torture, voilée commodément par l'autorité morale et intellectuelle de St Thomas, qui, mort depuis longtemps, ne peut se récuser. Le terroriste, dit-on, ferait la guerre sans s'exposer aux risques qui sont le lot de tout soldat : être blessé, ou tué. La torture est une manière d'infliger ces souffrances, et de refaire peser sur le terroriste ce auquel il veut lâchement échapper. En quelque sorte, elle rétablit la balance. La Cité Catholique ne se pose pas plus de questions que cela ! Voilà, nous n'en doutons pas, quelque chose qu'on ne raconte pas tous les jours aux lecteurs de Permanences. Selon la Cité, la torture serait légitime, vas-y mon gars, tu peux y aller, on couvre ton salut éternel et en plus tu sauves ton pays et tu poses une action conforme à la vertu de justice. Signé : des docteurs de l'Eglise qui te veulent du bien.
Il y a plus amusant : l'un des « mistigris » que poursuit l'auteur n'est autre que le Père Georges Grasset, qui nous a prêché il y a longtemps une retraite de St Ignace, en compagnie d'un prêtre pétulant du diocèse de Lyon, célèbre à l'époque pour s'être enchaîné plusieurs fois dans des unités de gynécologie / obstétrique de quelques hôpitaux de la région, en signe de protestation contre l'avortement (et en toute illégalité, ce qui contribua à consommer l'argent de quelques pieux fidèles en frais de justice répétés).
Mme Robin n'arrive pas à mettre la main sur le Père Grasset ; elle récolte à la place les rumeurs sur l'intéressé. Ce serait le confesseur du général Videla, ou de quelques autres toujours en liberté à Buenos Aires après la loi d'amnistie. Ce serait un « homme de l'ombre », selon un permanent du « Centre » (le nouveau nom de la Cité Catholique, qui en change tous les dix ans). C'est très plausible ; l'intéressé lui-même m'avait confirmé qu'il passait la moitié de son année en Argentine. Je m'imaginais un peu naïvement qu'il vivait dans une petite mansarde, avec vue sur cour, dans un immeuble borgne avec du linge séchant aux fenêtres, se livrant à je ne sais quelles besognes humanitaires. Il semblerait que la scène se passe plutôt sous les ors du Circulo Militar de Retiro, en compagnie de bourreaux non repentis.
Là où Marie-Monique Robin quitte l'objectivité du journaliste pour endosser la casaque du militant, c'est lorsqu'elle s'acharne sur le père Grasset au point de livrer sur internet son adresse en Argentine (à quelques blocs de mon hôtel, cet été). C'est un peu dommage, d'autant qu'on ne voit pas à quoi cela pourrait servir, fors à nourrir la vindicte.
La retraite de votre serviteur avec le Père Grasset n'était pas triste, en effet ; il avait en effet un talent pour flatter son auditoire de jeunes tradis couillus (duas habent, et bene pendentes), pour les caresser dans le sens du poil, leur bourrer le crâne et niquer (pardon... « combattre ») l'ennemi principal selon lui : le sexe. Et tout le monde connaît la libido dévorante du jeune tradi couillu, qui se retient jusqu'au mariage - enfin, c'est ce qu'ils disent.
Je me souviens encore d'anecdotes piquantes (au sens propre), telle la planche à clous qu'il nous conseilla de nous faire pour vaincre les tentations nocturnes. C'était une réédition métallique des ronces de St Benoît : des punaises fichées dans un morceau de carton. En cas de besoin, il fallait marcher dessus, pieds nus. Il expliquait, dans son inimitable style qu'alors, « le sang partait des endroits où il ne devait pas se trouver ».
Je me souviens aussi du jour où il raconta comment il avait surpris dans les cabinets un garçon en train de se masturber. « Il ne faisait pas le fier, croyez-moi ». C'était selon lui la preuve que la masturbation était mauvaise : le garçon savait, intimement, de manière innée, que c'était mal. On peut aussi penser que le pauvre gosse, croyant la porte des cabinets fermée, a été surpris de la voir s'ouvrir, et pire, de la voir s'ouvrir sur le P. Grasset, raide comme la justice. Ce n'est peut être pas ce que l'on voudrait contempler lorsqu'on se branle. Ah ! Si seulement il avait eu la planche à clous miraculeuse, ou un sécateur à portée de main. Il vaut mieux se faire eunuque pour le royaume de Dieu, telle était la spiritualité du bon père...
Je parlais de bourrage de crâne, croyez que je n'exagère pas. Lors des consultations prévues dans les Exercices de St Ignace, le père Grasset tenta de guider mes aspirations politiques vers le Front National, en recommandant la frange catholique et en me décommandant la frange païenne (Martinez : recommandé ; Mégret : déconseillé). Lors d'un examen de mes goûts musicaux, le bon père me déconseilla formellement Mahler, trop lourd, trop boche, et me recommanda fortement d'écouter du Rameau à la place ; cela pourrait faire du bien à mon salut. Comme on le voit, les Exercices embrassent l'homme tout entier. Après cela, on comprend que j'aie préféré faire ma confession générale à l'autre prédicateur.
La dernière fois que j'ai vu le P. Grasset, ce devait être en 96 ou 97, il logeait chez les bénédictines de Rosans ; peut-être faisait-il fonction d'aumônier. Quelques mois plus tard, il était reparti ailleurs. L'enquête de Mme Robin me laisse un peu sur ma faim ; ce qu'elle dit du bonhomme colle avec ce que j'en sais, mais finalement, rien de son implication et de ses connivences n'est réglé. Je sais que c'est l'homme de la planche à clous ; je sais que c'est vraisemblablement l'homme de quelques complaisances gênantes ; je ne sais pas si c'est l'homme de quelque chose de plus grave.
Voici comment Mme Robin parle du père Grasset dans le journal argentin Pagina 12 ; la traduction a été mise sur le net sur le site du RISAL (Réseau International Solidarités d'Amérique Latine).
« Le personnage clé de cette organisation est le père Georges Grasset, qui a été le confesseur personnel de Videla et qui vit encore en Argentine. Guide spirituel de l'OAS qui, avec ses commandos Delta (escadrons de la mort) a essayé d'empêcher par les armes l'indépendance de l'Algérie. Dans l'Armée argentine, il existait un courant ultra-catholique intégriste, qui explique pourquoi l'influence des Français a été si importante. Lorsqu'il vient à Buenos Aires - Grasset vit à la Rue...(nom de la rue supprimé, pour ne pas faire ce que nous reprochons à l'auteur, NdNelly) - il entretient des liens avec la congrégation de Monseigneur Lefebvre, un évêque intégriste français qui a depuis été excommunié par le Vatican [Il est décédé en 1991 - né en 1905 ; la Congrégation a toujours son centre à Ecône, en Valais-Suisse, sous le nom de Fraternité sacerdotale Saint Pie X, ndlr]. Cette congrégation possède quatre monastères en Argentine, la principale à La Reja. Lorsque je suis allée à La Reja, j'ai parlé avec un curé français qui m'a dit : « Pour sauver l'âme d'un curé communiste, il faut le tuer »
L'un des enseignements du livre, c'est de mettre à jour une espèce d'internationale informelle d'extrême droite qui, sous la pression d'une menace communiste, a appliqué des méthodes formellement condamnées par le catholicisme qui était d'un des piliers revendiqués de la civilisation qu'elle entendait défendre. En fin de compte, cette internationale, née des besoins d'adaptation à un nouveau style de conflit, est devenue une machine d'autant plus sanguinaire que ceux qui la servaient étaient convaincus de sa nécessité.
Un second enseignement, c'est que cette machine de torture est devenue peu à peu son propre but, au point d'être utilisée par des gouvernements contre leur propre peuple ; ce qui était une technique de guerre est devenue une technique d'oppression.
Le troisième enseignement, c'est que les développeurs et les propagateurs enthousiastes de cette technique étaient français, et fiers de leur enfant monstrueux.
Le quatrième enseignement, c'est que la machine à torturer anti-communiste, ses auteurs et ses servants présentent des liens organiques avec le milieu catho-tradi ; qu'ils ont été bénis par ses prêtres, ses gourous et qu'ils ont cru agir en conformité avec ses enseignements. Ces liens restent encore à creuser. Le fait que l'on rencontre indistinctement la Cité Catholique, Chiré, l'OAS et les théoriciens de l'école de guerre dans les années 50 et 60 ne doit pas tromper : ces liens existent bel et bien. On trouvera certainement, si l'on cherche, quelques mythes ou scènes fondateurs du traditionalisme moderne dans l'histoire des « escadrons de la mort ».
Un autre enseignement, encore, c'est que la torture ne marche pas. Elle est immédiatement efficace pour obtenir un renseignement ; sur le long terme, elle est connue et décuple l'énergie de résistance des populations opprimées. L'Algérie est devenue indépendante, l'Amérique du Sud a rejeté toutes ses dictatures, la Russie ne se sort pas du bourbier tchétchène par plus que l'Algérie de ses troubles internes.
On a beaucoup glosé, et on glose encore, sur la pureté du marxisme et l'application déviante qui en aurait été faire par Lénine puis Staline : les politiques auraient détruit une belle idéologie qui n'était en rien grosse des goulags et de dizaines de millions de morts. Le rapprochement entre le catholicisme traditionaliste et des entreprises de mort telles que l'opération Condor, à l'échelle d'un continent, devrait poser la question de l'inspiration des dictateurs de droite depuis cinquante ans. L'OAS, Condor, la torture en Algérie : sont-ce là des produits regrettables et évitables d'une politique de camp retranché qui ne voulait que le bien et la liberté des populations ? Ou est-ce la conséquence nécessaire d'une idéologie religieuse mutante qui ne supporte rien d'autre qu'elle et détruit tout ce qui veut lui barrer la route ?






 Judas Iscarioth, l’apôtre félon (Serge Boulgakov)
Judas Iscarioth, l’apôtre félon (Serge Boulgakov)